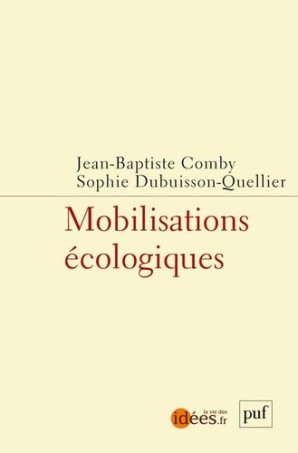Fondation de l’Écologie Politique : Dans quel moment intellectuel et politique s’inscrit la sortie de cet ouvrage collectif ?
Sophie Dubuisson-Quellier : La commande de l’éditeur portait à l’origine sur la “citoyenneté écologique”. Je craignais un peu de devoir redire des choses sur la consommation engagée. J’ai proposé une analyse assez particulière du sujet, je ne pars pas des individus eux-mêmes mais des organisations. Je montre que leur enjeu est surtout d’engager les consommateurs dans des démarches militantes, mais que ça marche assez peu et surtout, que cela donne une prise phénoménale à une récupération de la critique. Je n’avais pas envie de montrer à voir une sorte de panorama ravi sur ces questions de consommation engagée. En revanche, il manquait un ouvrage qui pouvait rendre compte des évolutions récentes des mobilisations. J’ai rapidement proposé à Jean-Baptiste Comby de collaborer sur ce projet, même si nous venons de sociologies très différentes, nous avions beaucoup de points de vue en commun.
Jean-Baptiste Comby : Pour compléter je dirais que la chose que nous avons en commun avec Sophie Dubuisson-Quellier, c’est que l’on s’intéresse depuis une bonne quinzaine d’années à des militants proches des lieux de décisions politiques et économiques et que l’on peut qualifier de réformateurs. Si je reviens sur le contexte intellectuel et scientifique, ce livre fait aussi le constat d’un manque, en France, d’enquêtes longues et sérieuses sur l’espace des mobilisations écologiques et sur la manière dont celui-ci se structure.
‘On peut faire le constat que le mouvement écologiste s’est recomposé et redynamisé depuis une dizaine d’années.’
Nous avons des travaux importants sur les écologistes et leurs pratiques militantes mais peu sur la morphologie du mouvement écologiste. Il faut cependant signaler ici la thèse de Malo Herry sur l’espace des organisations environnementales qui offre des perspectives très importantes et dont on peut regretter qu’elle n’ait pas été vraiment valorisée via des publications scientifiques. Reste que cet ouvrage ne fait pas tant le point qu’il ne défriche ces questions. Et cela d’autant plus que sur le plan politique, on peut faire le constat que le mouvement écologiste s’est recomposé et redynamisé depuis une dizaine d’années. Notre objectif est donc de tenter d’apporter des éléments de clarification et de compréhension à ces transformations.
Si on se penche sur le contenu de l’ouvrage, quelle est la place des mobilisations écologistes dans le champ des contestations ? Des convergences se dessinent-elles ?
Jean-Baptiste Comby : Je dirais deux choses. On peut commencer à répondre en revenant sur l’organisation du livre puisqu’il est composé de cinq chapitres dont trois qui correspondent à des rapports de domination ou à des variables sociales particulières. Il y en a un sur les rapports de genre avec le chapitre sur les écoféminismes de Geneviève Pruvost, il y a le chapitre de Marie Thiann-Bo Morel qui met plutôt l’accent sur la variable ethno-raciale et celui de Flaminia Paddeu qui porte plutôt sur les conflits de classe. Ces chapitres abordent la façon dont le mouvement écologiste se décloisonne et s’ouvre à des combats connexes contre d’autres formes de domination, ce qui n’était pas forcément le cas avant. Ce phénomène a amené des nouveaux militants mais l’ouverture n’a pas été simple pour autant, comme le racontent aussi ces trois chapitres.
‘une des particularités du mouvement écologiste dans le champ des contestations c’est justement d’interroger cette dimension territoriale, ce rapport à l’espace, l’articulation du local et du global‘
Et, il y a deux autres chapitres, celui d’Edouard Morena et celui de Stéphanie Déchezelles qui ont en commun d’aborder la variable territoriale. Edouard Morena s’intéresse plus aux territoires supra-nationaux et aux négociations diplomatiques donc à une échelle plutôt globale et Stéphanie Déchezelles montre comment une des spécificités du mouvement écologiste est d’amener à repenser la dimension du territoire dans les conflits sociaux. Et je crois qu’une des particularités du mouvement écologiste dans le champ des contestations c’est justement d’interroger cette dimension territoriale, ce rapport à l’espace, l’articulation du local et du global. Alors ce n’est pas nouveau, mais peut-être que, par rapport à d’autres mobilisations, c’est quelque chose qui le caractérise et dont l’examen pourrait être approfondi.
Le deuxième point sur lequel je souhaitais revenir traite de la question des convergences qui est devenue un mot d’ordre depuis une petite dizaine d’années. Il y a une convergence qui est recherchée et affichée mais ce n’est pas parce que vous mettez deux militants avec des cultures politiques différentes côte-à-côte que vous faites de la convergence et que ces militants vont vraiment, durablement, réussir à se battre ensemble. Il y a des obstacles sociaux à cette convergence qui résistent aux intentions stratégiques, louables par ailleurs.
Sophie Dubuisson-Quellier : Ces derniers mois les différentes mobilisations écologiques ont été très présentes, visibles, sous plein de formes différentes, plus radicales : des occupations, des façons aussi de venir heurter volontairement la sensibilité – je pense au jet de soupe-, des façons d’intervenir dans des manifestations publiques pour occuper le terrain, etc. On a beaucoup parlé des manifestations pour le climat également, et les médias rendent compte de tout ça. Et puis on a traversé une mobilisation sociale autour de la réforme des retraites qui a pris des traits extrêmement classiques et, au fond, les liens entre les deux peuvent être interrogés. On peut se dire que la mobilisation sur les retraites a pris le pas sur les autres mobilisations, sauf que non, puisque les mobilisations écologistes sont toujours là, on a eu quand même des mobilisations très fortes contre les bassines au milieu de la mobilisation contre la réforme des retraites. Et, à mon sens, cela vient éclairer pas mal de choses qui sont traitées dans le livre, c’est qu’au fond, aujourd’hui, c’est encore compliqué pour les écologistes de faire convergence avec des causes plus larges. Il y a eu des tentatives : parler du travail, c’est aussi parler du temps de travail, des conditions de production de la richesse, du temps du quotidien, c’est aussi parler des horizons de vie des futures générations, des questions de santé et tout ça n’est pas absent de l’agenda des mobilisations écologistes. Donc il y a des terrains communs qui ont été évoqués par les militants mais ça reste compliqué. Il y a des sociologies et des cultures militantes qui peuvent l’expliquer mais on a besoin de davantage de sciences sociales, d’enquêtes originales capables d’éclairer ces questions. De ce point de vue, le livre défriche cet objet des articulations entre les mobilisations écologistes et d’autres mobilisations, on espère qu’il pointe les questions pour lesquelles les sciences sociales sont attendues pour permettre de mieux comprendre les conditions d’articulation entre ces deux types de lutte.
Jean-Baptiste Comby : Par rapport au mouvement des retraites, il faudrait l’examiner de manière plus précise mais il apparaît que le mouvement écologiste, déjà en 2019, s’était posé cette question notamment à travers quelques tribunes encourageant les écologistes à s’emparer de ces questions-là. J’ai le sentiment, à confirmer donc, que cela s’est accentué en 2023, par exemple avec Reporterre qui a fait toute une série de papiers pour expliquer en quoi cette réforme des retraites était d’une certaine façon anti-écologique. On voit dans les manifestations beaucoup de personnes qui font le lien, sur les pancartes, les graffitis etc. Et puis il y a eu cette répression à Sainte-Soline qui est venue résonner avec celle qui, suite au 49-3, s’est abattue sur le mouvement contre la réforme des retraites. Et ce front commun contre les violences policières n’est pas nouveau ; on parle dans le livre de la marche ayant réuni la “génération Adama” et la “génération climat” derrière un même mot d’ordre, “on veut respirer”, qui soulignait que les pollutions comme la répression policière étouffent. Je trouve que ça revient sur quelque chose qu’on n’a pas traité dans le livre qui est la criminalisation du mouvement écologiste, ce regrettable angle-mort étant lié au peu d’études sur ce sujet pourtant important.
Sophie Dubuisson-Quellier : Ce qui était particulièrement frappant, c’est qu’à mesure qu’on écrivait sur ces sujets-là, ils évoluaient, ils changeaient, il y avait aussi un côté épreuve de la réalité qui était assez déstabilisant et on voit bien qu’on n’a pas rendu compte de toutes les évolutions récentes. Il se passe effectivement des choses mais je trouve que sur cette question du travail, il y avait un véritable enjeu pour les écologistes à s’emparer de cette question-là et justement de faire les connexions avec les problématiques de justice sociale. Je ne dis pas qu’il n’y a rien eu, il y a eu des publications, des prises de parole dans les manifestations et des personnalités qui font la jonction mais je trouve qu’il y avait une opportunité dont les mouvements ne se sont pas totalement saisis, c’est une question très compliquée mais probablement assez essentielle.
Le mouvement des gilets jaunes a ouvert un temps de recomposition du débat écologique, notamment autour de la justice sociale. Comment percevez-vous l’évolution des débats ? Quels rapprochements permettent-ils ? Quels angles morts persistent ? Et comment le mouvement écologiste s’en est emparé ?
Sophie Dubuisson-Quellier : On peut revenir sur cet épisode parce qu’il dit beaucoup de choses et notamment il montre l’intérêt d’avoir une approche par les sciences sociales. Si on regarde le traitement médiatique et politique des Gilets Jaunes, on est frappé par le fait qu’il a été identifié comme une prise de distance d’une partie de la population vis-à-vis de la question écologique. Les enquêtes en sciences sociales qui sont aujourd’hui publiées sur les Gilets Jaunes montrent une réalité très différente de ce cadrage qui nous a été proposé. On voit à la fois des positionnements beaucoup plus nuancés par rapport aux questions écologiques – ce qui pose la question de savoir si toutes les formes d’écologie peuvent être renvoyées à quelque chose comme l’écologisme – mais en tout cas on n’a pas d’opposition nécessairement frontale.
‘ce que permet de comprendre [le mouvement des Gilets jaunes], c’est l’importance de la manière dont on intègre cette question des inégalités dans une problématisation écologique’
On avait même des sensibilités à la cause écologiste fortement partagées par une partie des militants. Au fond, ce que permet de comprendre cet épisode, c’est l’importance de la manière dont on intègre cette question des inégalités dans une problématisation écologique. La question des inégalités se pose de plein de façons. De manière un peu schématique, on a la question des inégalités d’exposition qui est traitée par la justice environnementale : quelles sont les populations qui sont exposées aux risques des dégradations de l’environnement ? On a aussi la question des inégalités de contribution aux désordres écologiques qui a été beaucoup mise sur le devant de la scène ces derniers mois en montrant que certaines populations émettent beaucoup plus que d’autres. Et ce qu’a introduit cet épisode, c’est la question des inégalités d’efforts face à la transition. C’est-à-dire à qui on demande le plus d’efforts ? La taxe carbone qui a déclenché le mouvement pèse évidemment plus lourd pour ceux dont le budget est largement grevé par des dépenses contraintes de carburant pour aller travailler, faire les courses ou atteindre les lieux de service public. Et quand on regarde ces trois formes d’inégalités, elles se recoupent de manière assez sévère. Ceux qui sont le plus exposés sont ceux qui contribuent le moins mais ceux à qui on va demander le plus d’effort : ils payent lourdement la facture écologique. Donc on a là une sorte de modèle des injustices qui se combinent et qui fournit aussi, je trouve, une trame pour permettre aux questions écologiques de s’articuler davantage à des questions sociales assez classiques et essentielles.
Jean-Baptiste Comby : Cette question de l’effort, c’est quelque chose que Valérie Deldrève et Jacqueline Candeau ont pointé depuis 15 ans mais c’est vrai que cette sociologie des inégalités environnementales est assez méconnue, y compris chez les écologistes. Pour répondre à votre question, étonnamment mais ça s’explique, la question des inégalités écologiques du point de vue de la contribution a été plus facilement saisie par les militants écologistes, on l’a vu l’été dernier avec le traçage des jets privés, le sabotage de golfs, la critique des piscines par rapport à la question hydrique, c’était assez frappant. Je trouve qu’il y a encore une réelle difficulté à penser la justice environnementale au sens de ceux qui souffrent le plus. Il y a deux livres qui s’emparent de cet enjeu, celui de William Acker sur les gens du voyage et celui de Fatima Ouassak qui apporte quelque chose de très original sur ce que peut être une écologie depuis les quartiers populaires. La question de la justice environnementale, c’est aussi celle de la santé environnementale. Et là, on a un millefeuille institutionnel (avec de nombreuses agences et des ministères de la Santé et de l’Environnement peu connectés là-dessus) et un éparpillement associatif concernant la prise en charge des victimes de pollution. Cela, c’est mon hypothèse, n’a pas favorisé l’émergence d’un fort mouvement pour la justice environnementale comme on a pu le voir en Inde ou aux Etats-Unis, capable de montrer que ceux qui souffraient n’étaient pas situés n’importe où socialement.
‘La question de la justice environnementale, c’est aussi celle de la santé environnementale. Et là, on a un millefeuille institutionnel et un éparpillement associatif […] qui n’a pas favorisé l’émergence d’un fort mouvement ‘
En France ce mouvement là je ne l’ai pas vu, ce que je vois plutôt c’est la critique de modes de vie ostentatoires, d’une forme d’abondance, or je pense qu’il y a une réflexion à avoir là-dessus. Et les collègues qui travaillent sur ces questions-là n’ont pas franchement inscrit leurs travaux dans ces perspectives de justice environnementale, notamment parce qu’ils sont dans des espaces académiques qui ne les ont pas encouragés à le faire. Notre collègue Emmanuel Henry qui est un des spécialistes de ces questions, a cependant dédié un chapitre dans son dernier livre « Ignorance scientifique et inaction publique » à ces enjeux. Il n’apporte pas forcément de réponses mais il ouvre la réflexion. Sans aller plus loin, nous sommes face à un angle-mort à la fois militant, scientifique et institutionnel.
Sophie Dubuisson-Quellier : Sur cette question-là, je peux citer les travaux de mon collègue Jean-Noël Jouzel qui travaille sur les agriculteurs exposés aux pesticides et qui aborde ces questions de justice environnementale. On pense aussi aux travaux de Valérie Deldrève mais les travaux restent beaucoup moins développés en France qu’ils ne le sont dans la littérature anglo-saxonne. Les militants en France mobilisent également moins la justice environnementale que ce n’est le cas aux Etats-Unis, où des générations de militants se sont forgé une culture militante sur l’environnement à travers la question de la justice environnementale. C’est vrai que le contraste est vraiment saisissant de ce point de vue.
Quelles questions se posent aux acteurs de l’écologie (ONG, partis, mouvements) qui souhaitent élargir le front écologique à de nouvelles franges de la société ?
Sophie Dubuisson-Quellier : Il n’appartient pas aux chercheurs de dire aux militants ce qu’ils doivent faire ou ne pas faire. Cependant, le monde militant pourrait aussi davantage prendre connaissance des travaux en sciences sociales. Par exemple, je suis frappée par l’approche très cognitive et psychologique de cette crise écologiste ou de l’inaction privilégiée par les militants : le diagnostic principal qui est fait est que la société n’agit pas suffisamment pour résoudre la crise écologique parce que les individus seraient trop peu conscients ou insuffisamment formés. Il en découle des actions qui visent à démultiplier les formations vis-à-vis des individus, on pense aux outils de type fresques du climat, ou des décideurs, mobilisant d’ailleurs souvent les scientifiques du climat qui vont former les élus ou l’administration. Au fond, cette vision, très héritée des théories de l’action planifiée, considère que les attitudes précèdent l’action : il suffit donc de donner la bonne information, pour accroître la sensibilité des acteurs et leur permettre de passer à l’action.
‘Ce n’est pas parce qu’un décideur aura compris ce qu’est le changement climatique qu’il pourra aller contre des règles qui favorisent ses décisions carbonées, c’est parce qu’on changera ces règles‘
On est très loin des sciences sociales qui montrent qu’en réalité les décisions des acteurs sont prises dans des routines, des règles, des façons d’agir, des structures d’intérêts, des interdépendances, qui contraignent très fortement les acteurs. Ce n’est pas parce qu’un décideur aura compris ce qu’est le changement climatique qu’il pourra aller contre des règles qui favorisent ses décisions carbonées, c’est parce qu’on changera ces règles. De même, ce n’est pas parce qu’un individu comprend que ses activités émettent beaucoup de carbone qu’il peut changer ses pratiques, c’est bien plus parce que les pratiques moins carbonées vont devenir pour lui économiquement ou pratiquement plus accessibles. De même, j’ai été frappée par les réactions très vives d’une partie de la communauté écologiste vis-à-vis de formes de mobilisations qui relèvent plus de l’action directe, comme le jet de soupe ou les actions d’occupations. Comme s’il y avait des formes de mobilisations plus efficaces que d’autres. En réalité, les travaux en sociologie des mobilisations montrent qu’il est toujours très difficile d’attribuer de manière certaine une efficacité à telle ou telle mobilisation, mais ils établissent aussi le rôle très fort des mobilisations, et notamment de leur hétérogénéité, dans le changement social. Bref, on mesure le gain qu’il y aurait pour les organisations militantes à mobiliser à côté des savoirs très légitimes comme l’économie, le droit, l’expertise climatique, d’autres savoirs comme ceux des sciences sociales.
Jean-Baptiste Comby : Je rejoins l’idée que, depuis le mouvement des Gilets Jaunes, il y a quelque chose qui s’est ouvert et qui n’est pas encore refermé. Je perçois notamment que les militants écologistes s’ouvrent aux sciences sociales et commencent à s’en saisir. Cela vient réduire leur méconnaissance du monde social et de ses rouages, méconnaissance qui explique leur difficulté à comprendre les mondes populaires pour s’en rapprocher et forger des alliances.
Pour conclure, quelles sont, selon vous, les prochaines ?
Sophie Dubuisson-Quellier : À la fois qu’il y ait plus de travaux en sciences sociales sur ces questions, et qu’ils alimentent davantage la compréhension de la crise climatique, qui est avant tout une crise de notre modèle politique, économique et social
Jean-Baptiste Comby : Je pense qu’il faudrait avoir des données un peu plus globales sur le mouvement écologiste, ses différentes composantes et ses ancrages sociaux. On manque de grandes enquêtes là-dessus. Enfin, je pense, qu’il y a un enjeu d’indépendance de la recherche sur ces questions-là qui est toujours à défendre et à rappeler.
Propos recueillis par Kévin Puisieux et Céleste Lacombe
TÉLÉCHARGER L’ENTRETIEN :
RETROUVER LE LIVRE :