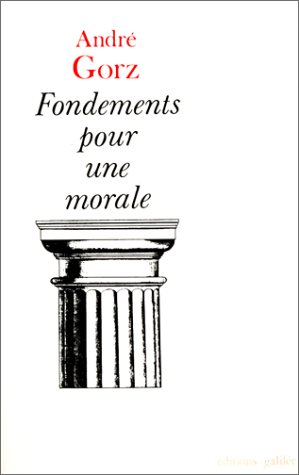Adeline Barbin est agrégée et doctorante en philosophie politique au Centre de Philosophie Contemporaine de la Sorbonne.
Ses recherches portent sur l’évaluation et le contrôle des technologies. Elle a notamment publié André Gorz. Travail, économie et liberté, CNDP, 2013.
L’écologie politique d’André Gorz est un programme de défense de ce qu’il nomme le monde vécu contre l’aliénation du sujet que produisent le capitalisme et l’extension du champ d’une rationalité économique. Le monde vécu est conçu comme le lieu où les conditions de l’autonomie doivent être réunies afin que le sujet puisse pleinement advenir à lui-même, c’est-à-dire assumer les fins et les valeurs de ses actions. On a ainsi souvent souligné que Gorz n’était pas un écologiste classique si l’on entendait par là un théoricien préoccupé par la biodiversité ou le réchauffement climatique. Ce que le projet écologique de Gorz veut protéger, c’est le milieu de vie des êtres humains, un oikos que les individus puissent ressentir comme habitable et dans lequel ils puissent choisir leur manière de vivre:
De toutes les définitions [de l’écologie] possibles, j’aimerais privilégier d’abord la moins scientifique, celle qui est à l’origine du mouvement écologiste, à savoir le souci du milieu de vie en tant que déterminant de la qualité de vie et de la qualité d’une civilisation[1].
Qu’en est-il alors de la notion de nature ? C’est dans les Fondements pour une morale qu’André Gorz théorise le plus clairement cette notion, et ses analyses permettent de mieux comprendre de quoi il est question – et de quoi il n’est pas question – dans son projet écologique.
Le terme de «nature» dans les Fondements désigne d’abord ce que Gorz nommera seulement ensuite «monde vécu». C’est un ensemble constitué d’éléments à la fois naturels et d’« acquis culturels assumés comme immuables[2]». La dimension naturelle est essentielle en tant que le sujet d’André Gorz est un corps-sujet. L’auteur, loin de ne se soucier que des possibilités morales les plus hautes, accorde une grande importance à la dimension de l’incarnation physique de l’être humain: celui-ci
ne peut aucunement s’empêcher par quelque décret volontaire de sentir, d’être affectivité, de dévoiler le monde avec son corps qui est son point de vue sur le monde et l’instrument cardinal de tout dévoilement[3].
Ce corps-sujet réclame des conditions physiques particulières. Son bien-être et son autonomie ne sauraient se développer dans n’importe quelle situation environnementale: au nombre des conditions de ce développement figure donc la nature au sens prosaïque de lumière naturelle, d’eau fraîche, de végétation et de paysages plaisants. Mais le monde vécu est aussi plus que cela. S’appuyant sur les leçon de la phénoménologie de Husserl et de Merleau-Ponty, André Gorz définit le monde vécu comme le monde que nous donne originairement notre corps, celui qu’il déploie dans sa réalité sensible, celle-ci ne pouvant être limitée à des propriétés sensorielles: le corps-sujet évolue dans son monde quotidien à partir d’un ensemble de pratiques non-théorisées, qu’il a acquis de la même manière qu’il a appris à marcher ou à parler. Le monde vécu est donc constitué de savoir-faire, d’habitudes, de techniques familières et de conduites et de normes qui vont de soi. Cette «culture du quotidien», selon l’expression de l’auteur, est ce qui nous rend le monde proche et rassurant, ce qui nous permet d’y évoluer parce qu’il constitue un socle d’évidences et de certitudes sur lequel nous pouvons déployer notre existence, avant d’éventuellement le remettre en question.
Ainsi comprise, la nature est le prolongement du corps, c’est-à-dire la partie du monde que nous nous sommes rendus «naturelle» au sens de familière et maîtrisable, ce qui nous la rend vivable:
La région du monde naturelle est celle que la vie naturelle «naturalise», annexe au corps comme son prolongement et sait parfaitement à même le corps ; c’est le monde en tant que la vie le mondanise et, au sens propre du terme, se l’incorpore par le simple déploiement de ses possibilités naturelles, rodées et acquises au contact de ses entours précisément[4].
Revenant sur la définition de la nature des années plus tard, André Gorz en propose une formulation qui en conserve les mêmes éléments et met clairement en exergue ce double aspect de nature et culture ainsi que l’importance du caractère évident que celle-ci doit avoir pour les individus qui s’y meuvent:
La ‘nature’ dont le mouvement [écologique] exige la protection n’est pas la Nature des naturalistes ni celles de l’écologie scientifique: c’est fondamentalement le milieu qui paraît ‘naturel’ parce que ses structures et son fonctionnement sont accessibles à une compréhension intuitive; parce qu’il correspond au besoin d’épanouissement des facultés sensorielles et motrices ; parce que sa conformation familière permet aux individus de s’y orienter, d’interagir, de communiquer ‘spontanément’ en vertu d’aptitudes qui n’ont jamais eu à être enseignées formellement[5].
Le naturel est alors la même chose que l’habituel, et diffère selon chaque société et au cours de son histoire. Par conséquent, il ne saurait y avoir de nature «naturelle»: le monde est humain, ce qui est parfaitement cohérent avec le point de départ existentialiste de l’auteur, celui d’un homme expulsé de la nature par sa conscience. Du point de vue du projet écologique, cette posture théorique explique pourquoi l’écologie n’est pas le respect d’une nature sacrée, empreinte de religiosité ou de spiritualité. Il n’existe en effet pas de nature indépendante de l’homme: «du fait qu’il n’y a pas de nature humaine, il ne saurait y avoir pour l’homme de monde purement naturel[6]». L’homme organise toujours ce qui l’entoure. De même, la nature ne peut être celle indifférente et objective de l’écologie scientifique, une nature réduite à des notions de stocks et de seuils de tolérance : cette nature-là n’est pas la nature du monde vécu, mais une nature informée, mathématisée, par des savoirs scientifiques et économiques qui substituent une rationalisation outrancière au vécu physique et psychique des individus.
Mais, par conséquent, la nature ne saurait non plus être ce avec quoi nous entrons en interdépendance, ni ce qui pourrait avoir une valeur intrinsèque. En témoigne l’examen des rapports entre l’homme et la nature dans les Fondements, qui permet d’identifier un second sens du terme de nature: l’homme y apparaît comme ce qui est prélevé sur une nature cruelle et indifférente, régie par des règles et des rythmes qui échappent à sa prise; la nature est ce qui a la capacité d’engluer la transcendance du sujet et qui, de toute façon, finira par l’emporter dans la mort: «la Nature, en ce sens, est inhumaine, ou mieux, antihumaine» et le monde humain «est antinaturel et conquis sur la Nature[7]». Ce qui fait que l’homme est homme est qu’il s’arrache à la naturalité et à l’animalité.
Gorz semble ainsi tomber sous le coup des reproches qu’adresse Serge Moscovici, dans La société contre nature, aux doctrines qui supposent une démarcation entre nature et société, et distinguent une nature immédiate et familière d’une nature objective et agitée qu’étudie le scientifique et qui nous est opposée[8]. L’être humain y est certes un être de nature mais qui n’est pas pour autant dans la nature. Le problème est que, aux yeux de Moscovici, un tel discours justifie l’utilisation de la violence comme moyen de domination: la nature est ce qu’il faut soumettre et exploiter afin qu’elle nous soit utile. La pensée de Gorz ne débouche pourtant pas sur de telles conclusions et, même, témoigne d’une grande proximité avec celle de Moscovici. Tous deux prônent la défense du milieu de vie, de l’autonomie, de la société civile et du temps libéré; interrogent la notion de progrès; ou encore, soulignent l’unité de luttes a priori différentes (antinucléaires, régionalistes, féministes, etc.)[9].
La raison pour laquelle la pensée de Gorz n’emprunte pas le chemin décrit par Moscovici est qu’il considère que toute domination sur la nature a nécessairement comme conséquence la domination d’un groupe d’hommes sur les autres, parce que la maîtrise d’une ressource naturelle ou d’une connaissance risque toujours d’être une maîtrise par quelques-uns seulement. Cette lecture s’appuie sur le troisième sens du terme de «nature» que l’on peut trouver dans les Fondements, et qui constitue une spécification du second: la nature y est la dimension et le destin biologiques de l’homme, ce que Gorz nomme son «existence naturelle». Elle désigne notre part de contingence et d’immanence. Cette part est bien sûr médiatisée par des acquis culturels (je peux avoir faim, mais c’est ma culture qui me dira comment combler ce besoin), mais elle reste la manifestation de la nature, au second sens décrit, dans le corps humain même. Elle nous lie à la terre, à notre espèce, au rythme des jours et à la mort. Il pourrait donc paraître souhaitable de la maîtriser autant que faire ce peut. Mais toute domination sur elle s’accompagne d’une domination sur les hommes: la connaissance du médecin est un pouvoir sur son patient, et ce même s’il l’utilise à des fins désirées par le patient lui-même; la possibilité pour les êtres humains de modifier et sélectionner leurs génomes se traduira par une augmentation sans précédent du pouvoir de certains groupes. Le hasard et la contingence naturelle, aussi mortifiants soient-ils pour l’homme et sa conscience, sont en effet, de par leur caractère aléatoire, la condition de l’égalité de tous. La maîtrise de ce hasard sera une maîtrise par certains seulement et ne sera donc pas libératrice mais, au contraire, fournira un moyen puissant et inquiétant de contrôler et de hiérarchiser les êtres humains. La domination de la nature se traduit donc par une violence exercée contre l’homme, ce dont le projet émancipateur de Gorz ne peut que s’inquiéter.
La nature qu’il s’agit donc de protéger dans ce projet d’écologie politique, et que le terme de «monde vécu» désigne plus clairement, est un environnement à la fois naturel et social organisé de telle sorte qu’il permet à chacun d’en comprendre les règles et de s’y orienter et de telle manière que personne ne puisse, par le monopole d’une ressource, d’une connaissance ou d’une technique, imposer des conditions de vie qui viennent supprimer ce socle nécessaire à l’émancipation du sujet. La nature en son sens plus physique, notamment comme ensemble de phénomènes vivants, ne reçoit donc de valeur qu’à l’aune du compas que constitue l’autonomie des individus.
[1] A. Gorz, «Où va l’écologie», interview donnée au Nouvel Observateur, 14 décembre 2006.
[2] A. Gorz, Fondements pour une morale, Paris, Galilée, 1977, p. 144.
[3] A. Gorz, L’immatériel, Paris, Galilée, 2003.
[4] A. Gorz, Fondement pour une morale, op. cit., p. 144.
[5] A. Gorz, «L’écologie politique, entre expertocratie et autolimitation», Ecologica, Paris, Galilée, 2008, p. 49.
[6] A. Gorz, Fondement pour une morale, op. cit., p. 144.
[7] A. Gorz, op. cit., p.166.
[8] S. Moscovici, La société contre nature, Paris, Seuil, 1994.
[9] Voir notamment S. Moscovici, De la nature : pour penser l’écologie, Paris, Métailié, 2002. Serge Moscovici nomme le thème qui regroupe ces luttes la « question naturelle ».