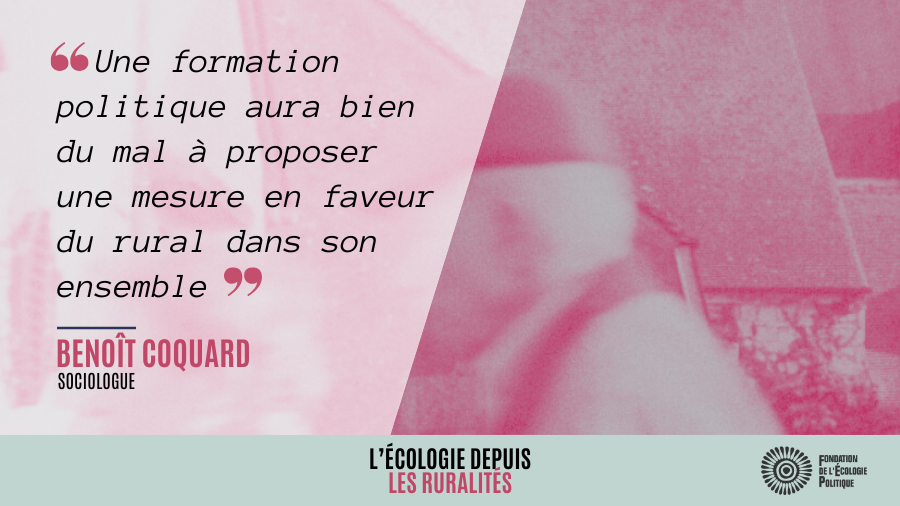Y a-t-il un ou plusieurs types de ruralités ?
Non seulement il y a différents types de campagnes, mais même à l’échelle de chaque ruralité, il y a des oppositions, de la conflictualité. Tous les ruraux ne pensent pas pareil, tous les gens du coin ne pensent pas pareil. Ils n’ont pas le même rapport à la mobilité, au travail, à la politique, à l’écologie, à tout ce que vous voulez, notamment parce qu’ils ne viennent pas des mêmes classes sociales. Ils n’ont pas non plus les mêmes parcours migratoires, le même genre, ils sont de différentes générations… Et dans l’espace local, ces personnes n’ont pas le même rôle, elles n’ont pas la même reconnaissance, aussi parce qu’elles n’ont pas les mêmes attributs sociaux. Certains responsables politiques viennent avec leurs « gros sabots » à la recherche d’un “vote rural” qui serait plus ou moins homogène, alors que les espaces ruraux sont différents, et même opposés politiquement bien souvent. Au sein même de chaque campagne, la population est distincte au même titre que celle des villes.
Certains responsables politiques viennent avec leurs « gros sabots » à la recherche d’un « vote rural » qui serait plus ou moins homogène, alors que les espaces ruraux sont différents, et même opposés politiquement bien souvent.
Benoît Coquard
La typologie que j’évoque dans mon travail – campagnes attractives / campagnes en déclin – est une typologie a minima. Pour aller plus loin, il y a des typologies de géographes, je pense notamment aux travaux de Pierre Pistre.
Les campagnes qui restent en déclin sont les anciennes campagnes industrielles plutôt du Nord et de l’Est de la France et quelques poches disséminées sur le territoire national liées à l’histoire industrielle du pays.
Je fais une distinction entre ces campagnes et les campagnes attractives, qu’on pourrait appeler les campagnes dominantes, qui attirent des habitants et qui sont sous l’aire d’attractivité des grandes villes. On y retrouve une part non négligeable et croissante de gens diplômés, bien qu’elle soit plus faible qu’en ville, et on a tendance à y retrouver une part plus faible qu’auparavant d’ouvriers, d’employés, de ce qu’on appelle « les classes populaires », typiquement des gens qui se sont mobilisés lors du mouvement des Gilets Jaunes.
Le rapport à la nature est-il différent d’un type de ruralité à un autre ?
Oui, les campagnes en déclin sont des régions où la question de l’écologie est peut-être plus compliquée à poser de prime abord, parce que ce sont des espaces où la nature et les espaces environnants sont moins patrimonialisés. On y catégorise moins cette nature comme belle, le paysage comme devant être protégé. Ce sont des campagnes qui ont, en lien avec l’industrie, mais aussi avec des formes d’agriculture, un marché du travail local, une économie locale, qui nourrit un regard productif sur la nature. L’idée de protéger la nature n’est pas quelque chose qui a permis de se construire une identité régionale locale. Le rapport à la protection de la nature est différent dans une région touristique quand cette dernière est un patrimoine territorial qui permet le développement économique de la région. Une formation politique aura bien du mal à proposer une mesure en faveur du rural dans son ensemble. Ce sera une mesure qui parlera à certaines catégories de la population rurale et qui aura un écho plus fort dans certains espaces locaux.
Il y a des manières de penser, des visions du monde et donc des comportements politiques, des rapports aussi au territoire qui sont alimentés par les rapports sociaux qu’entretiennent les groupes entre eux sur place. Cela renvoie à ce que Durkheim appelait à l’échelle de la société « la morphologie sociale » qu’on peut appeler une « morphologie sociale locale » qui sont les groupes sociaux en présence, la manière dont ils interagissent et dont ils vont construire de la norme et du conformisme. Ce qui est très important en milieu rural parce que l’interconnaissance y joue un rôle clé, renforçant les dynamiques de conformisme.
Par exemple, si l’on imagine le cas de deux femmes, du même âge, de la même catégorie sociale, l’une travaillant dans l’agro-industrie et vivant dans une campagne de l’Ouest, proche de Nantes, l’autre travaillant dans l’industrie dans l’Est de la France, ont toutes les chances de ne pas avoir tout à fait les mêmes visions du monde et les mêmes rapports notamment à l’écologie. Parce que l’une va être davantage amenée à côtoyer dans son quotidien des catégories sociales qui sont plutôt porteuses d’une vision positive de l’écologie telle qu’elle est définie aujourd’hui, qui se diront plutôt favorables à des mesures écologiques dans leurs pratiques de vie et vont mettre en avant certaines pratiques de protection. Alors que celle qui vit dans le grand Est, qui grandit dans un territoire marqué par le conservatisme politique, par le paternalisme industriel, où les populations diplômées sont parties durant le XXe siècle et où il n’y a pas l’installation de néo-ruraux, elle, elle va être moins exposée à des visions du monde qui adhèrent à l’écologie tout simplement parce que c’est une position qui n’est pas incarnée localement, et qui n’est pas légitimée dans les rapports sociaux locaux.
Dans votre livre vous indiquez que l’écologie est peut-être le seul clivage intergénérationnel dans le milieu que vous avez enquêté. De quelle manière s’exprime ce clivage ?
Il y a un rapport assez concret à l’écologie en milieu rural, parce que c’est un rapport à l’évolution de la nature et à la manière dont on va plus ou moins pouvoir en disposer. Un sujet d’opposition entre générations – ici entre jeunes et vieux chasseurs proches du monde agricole – pouvait être la disparition de la faune, massive, en milieu rural. J’ai pu entendre : « de votre temps, vous avez tout tué », « à cause des agriculteurs d’avant, il n’y a plus d’oiseaux, il n’y a plus de gibiers, on peut plus aller à la chasse comme on veut, on est obligé de payer très cher pour chasser dans des sociétés de chasse qui chassent le grand gibier ». Il y a une forme de privation de l’usage du territoire qui peut être pensée comme le fait que les anciens ont tout pris. Évidemment tous les jeunes n’ont pas ces réflexions-là.
Un sujet d’opposition entre générations – ici entre jeunes et vieux chasseurs proches du monde agricole – pouvait être la disparition de la faune, massive, en milieu rural.
Benoît Coquard
Gardons en tête qu’il y a aussi des normes communes qui se diffusent dans toute la France et dans toutes les classes sociales. Par exemple, j’ai pu voir mes enquêtés, de manière très banale, faire des réflexions à leurs parents sur l’utilisation des pesticides dans leur jardin, sur le rapport aux déchets, sur les décharges sauvages. Il y a tout un tas de sujets sur lesquels on se dit que les anciens ont toujours fonctionné comme ça, qu’ils ne s’en sont jamais préoccupés et qu’ils ne s’en rendent pas compte.
Il y a aussi de manière générale, un souci de soi, qui va dans le sens d’une pénétration des normes écologistes dans les différentes classes sociales, notamment autour de la qualité de l’alimentation. Les légumes avec des pesticides, on en entend parler, y compris dans les milieux populaires, notamment quand il s’agit de nourrir ses enfants. Et cela peut venir en tension avec le modèle d’agriculture locale, qui dans les campagnes productives est conventionnelle majoritairement. Quand j’étais encore en thèse, il y avait une mobilisation d’agriculteurs dans le cadre d’un conflit local avec des mesures étatiques qui amenaient à une restriction de l’utilisation de produits phytosanitaires, où les agriculteurs locaux se sont mobilisés de manière véhémente qui sont allés jusqu’à des formes de violence directe sur les personnes. Ils ont alors perdu le soutien de la population locale, il y a eu des voix qui ont commencé à s’élever pour dire que les pesticides à côté de l’école maternelle, du collège, ce n’était pas désirable ici. Ces messages étaient plutôt portés par des jeunes. Mais cela n’ouvre pas pour autant un comportement électoral nouveau.
Il y a aussi un souci de soi, qui va dans le sens d’une pénétration des normes écologistes dans les différentes classes sociales, notamment autour de la qualité de l’alimentation.
Benoît Coquard
À ces observations, il faut ajouter le poids des dernières années. La rivière du coin s’est retrouvée asséchée quatre années d’affilée, ce qui est sans précédent. Sur toute une partie de son parcours, elle est devenue souterraine. Des pêcheurs, plutôt des jeunes pêcheurs, ont critiqué le pompage en amont pour des golfs et des riches résidences secondaires qui remplissent leur piscine. Ici enjeux sociaux et écologiques se rencontrent, à l’image de ce que montre Jean-Baptiste Comby dans ses travaux. Quand se pose la question de qui va pouvoir encore avoir accès à ce qui reste de la nature, que réémerge la question des inégalités sociales, cela peut amener les gens à problématiser, à politiser les questions des ressources naturelles. Ça, c’est quand même nouveau et c’est quelque chose qu’ont plus de mal à faire les anciennes générations que les jeunes.
Qu’avez-vous pu voir du rapport de vos enquêtés aux politiques publiques associées à l’écologie?
J’ai pu observer une opposition unanime concernant les normes d’écologisation de l’habitat qui sont vues comme un nouveau frein administratif au fait de pouvoir construire comme on l’entend, d’avoir une autonomie dans son habitat. L’autonomie du style de vie, au travail, est très valorisée dans ces milieux populaires ruraux. Le fait de dire « maintenant il faut mettre tel type de matériaux », c’est vraiment quelque chose qui est unanimement contesté.
Il y a à la fois l’idée d’une entrave supplémentaire au nom des normes d’écologisation et l’idée qu’on ne va pas monter des dossiers, quémander des subventions à l’État pour avoir l’isolation de la maison, qu’on ne veut pas qu’une entreprise intervienne parce qu’on fait tout chez nous et, l’un dans l’autre, même avec l’argent de Ma Prime Rénov’, ça nous revient moins cher de faire nous-mêmes donc on n’ira jamais demander à une autre entreprise d’intervenir. Et ça c’est quelque chose qui rallie toutes les générations.
On peut penser au travail de Pierre Blavier sur ce couple de Gilets jaunes pour qui isoler son logement est devenu logique, mais qui par contre exprime ses réticentes sur les normes et le recours aux aides…
Oui tout à fait. Les personnes que j’ai vu devenir Gilets jaunes ont commencé à s’engager en avril contre les 80 km/h et la motivation était en gros de dire : « ils viennent encore nous dire qu’est-ce qu’on n’a pas le droit de faire chez nous », « nous on est obligé de faire 40 bornes pour aller au boulot, nous aussi on aimerait bien aller au boulot en vélo mais c’est pas comme ça que la vie est organisée ici ».
La question de l’autonomie dans l’organisation de sa vie quotidienne, dans les choix de vie réalisés : endettement pour la maison mais autoréparation de la voiture, installation loin du lieu de travail mais la voiture pour compenser.
Benoît Coquard
Quand ensuite il y a eu la taxe carbone, les groupes qui s’appelaient « la France en colère » – pas encore les Gilets jaunes – étaient fortement axés sur la question de l’autonomie dans l’organisation de sa vie quotidienne, dans les choix de vie réalisés : endettement pour la maison mais autoréparation de la voiture, installation loin du lieu de travail mais la voiture pour compenser. Et là, d’un seul coup, le mode de vie dans lequel on persévère est mis à mal au nom d’une pseudo écologie. à ce moment-là, on ne parlait pas tant d’écologie que de Macron. Personne n’accusait les Verts et ou un lobby écologiste de mettre en place la taxe carbone, ce qui était dénoncé c’était la volonté de leur prendre leur argent. Et il y a quelques Gilets jaunes qui ont commencé à dire : « Regardez Total, c’est eux les grands pollueurs et nous on est des petits pollueurs ». La photo où l’on voyait une grande raffinerie qui crachait de la fumée noire et une petite voiture devant, avec pour sous-titre : « À votre avis, qui est taxé par le gouvernement ? » a été très mobilisée. Contrairement à ce qui a pu être dit, ce n’était pas un mouvement anti-écologie.
Est-ce qu’il y a un lien entre ces pratiques un peu plus écologiques et les stratégies de différenciation que vous décrivez tout au long de votre ouvrage ?
Peut-être pas directement car c’est toujours sous l’angle productif mais il y a une différenciation entre ceux qui achètent beaucoup de choses, consomment beaucoup et ceux qui consomment moins. Quand on a un potager, on se débrouille pour aller récolter les fruits, faire les confitures etc. parce que cela coûte cher. Puisque que l’on a ça sur place, pourquoi aller l’acheter. Le sous-entendu derrière c’est qu’il faut vraiment être bête pour aller acheter plus cher des choses moins bonnes, ou il faut être feignant. Et ça c’est quelque chose de très important, il y a des pratiques qui pourraient être qualifiées d’écologistes qui rejoignent les ressorts psycho-sociaux des milieux populaires. Il s’agit de faire soi-même, d’avoir une autonomie dans son style de vie comme on disait tout à l’heure, mais aussi de ne pas se faire avoir, d’avoir dans les modes de consommation le goût du nécessaire comme disait Bourdieu, de faire le choix du nécessaire. On est aussi dans l’idée que, on sait combien ça coûterait de consommer autrement et on trouve ça bête. Et il peut y avoir ce discours là même chez la petite bourgeoisie à capital économique, « nous on ne paie pas ça, c’est vraiment une consommation naïve que d’aller acheter des fraises en primeur, d’aller consommer des fruits et légumes à cette époque ci dans les supermarchés ». C’est vu comme quelque chose d’irrationnel et qui marque une forme de fainéantise puisqu’il y a moyen de s’en sortir autrement.
Le sous-entendu derrière c’est qu’il faut vraiment être bête pour aller acheter des choses moins bonne, ou il faut être feignant.
Benoît Coquard
J’en parle un peu dans ma thèse : j’ai entendu beaucoup de discours sur les périodes de galère traversées par les jeunes autour de la vingtaine qui travaillaient en intérim et traversaient des périodes de chômage. Il fallait que même sans argent ils arrivent à s’en sortir, c’est quelque chose qui est valorisé auprès des autres. Je pense à une personne par exemple qui ne s’inscrivait pas au RSA, personne ne l’aidait, il avait vraiment zéro revenu. Il me disait : « moi j’allais tuer mon chevreuil et je mangeais des patates que j’avais plantés et j’ai survécu, sans rien demander à personne et sans faire l’aumône».
Une personne qui ne s’inscrivait pas au RSA, me disait : « Moi j’allais tuer mon chevreuil et je mangeais des patates que j’avais plantées et j’ai survécu, sans rien demander à personne et sans faire l’aumône. »
Benoît Coquard
À nouveau, on va valoriser le fait de pouvoir utiliser la nature. Il ne s’agit pas de montrer qu’on l’utilise pour la détruire, ce sont des activités, que ce soit le potager ou la chasse, de prélèvements, qui sont pensées, justifiées et légitimées par le fait qu’elles participent au développement de la nature. On peut critiquer ces discours-là mais il n’empêche que c’est justifié comme cela par les agents sociaux.
Il y a aussi le sujet de l’électrification de la voiture à tout va, le fait que ce soit de plus en plus cher et complexe de la réparer, qui met sous tension la capacité à faire soi-même, à faire appel à des potes, parce que maintenant il faut du matériel plus technique, plus cher.
Est-ce que ce rapport différent à la consommation s’inscrit dans une relation intergénérationnelle ?
Oui et d’une manière qui vient nuancer le propos que j’ai tenu au début. Je pense à un enquêté qui s’est acheté une voiture des années 90 à 500 € chez le garagiste local et il valorisait beaucoup le fait de bien l’entretenir et qu’elle ne tombait jamais en panne. Quand j’ai moi-même changé pour une voiture plus récente je l’ai justifié par l’accès au confort de la climatisation, notamment pour les enfants. J’ai mis en avant une préoccupation parentale, même si c’était également un achat de classe sociale, et il me dit : « Mais comment tu crois qu’ils faisaient les vieux avant ? ».
J’ai grandi avec ce discours : « Nous on n’avait pas tout ça, y’avait pas besoin de toutes ces conneries-là.
Benoît Coquard
Lui, comme beaucoup de jeunes ruraux, est tout le temps au contact des personnes âgées, qui disent : « Mais nous on n’avait pas tout ça ». C’est vraiment quelque chose qu’on entend très souvent. J’ai moi-même grandi aussi avec ce discours : « Nous on n’avait pas tout ça, y’avait pas besoin de toutes ces conneries là » avec en sous-entendu : « On était plus intelligents parce qu’on consommait moins, on se débrouillait plus. » discours qui valorise en fait toutes les qualités de l’homme ou de la femme accomplie en milieu populaire rural.
Quelle place et rôle pour la chasse dans la structuration des clivages au sein des ruralités ?
Les pratiques qui sont légitimes et les rapports à la nature qui sont légitimes, sont ceux qui prennent pied dans la morphologie sociale locale, qui sont incarnés par des gens qui ressemblent au groupe majoritaire, aux catégories les plus présentes. Pour ce qui est de la chasse, quand c’est une bourgeoisie allochtone, donc venant de l’extérieur, qui use des ressources naturelles locales, cela est souvent vécu comme un pillage des ressources et est considéré comme une chasse d’abattage qui risque de vider les forêts.
Quand ce sont des gens du coin qui chassent, cela dépend : si ce sont des gens du coin qui sont plus impliqués dans la vie locale, dans la vie sociale, la chasse est perçue comme une activité légitime. Je me rappelle des réponses à un sondage dans les milieux ruraux sur « êtes-vous pour ou contre la chasse? », qui laissait deviner que la plupart des gens n’aiment pas la pratique. Mais par contre, beaucoup connaissent des chasseurs et on pouvait entendre « moi j’aime pas du tout la chasse mais les chasseurs me laissent un cuissot de sanglier quand ils passent là » ou « mon compagnon chasse », notamment les femmes qui chassent très peu notamment dans les milieux populaires. Beaucoup n’aiment pas la pratique, mais comme ce sont des maris, des frères, des pères, la chasse reste légitime par l’intermédiaire des liens qu’elle mobilise.
Les rapports à la nature qui sont légitimes, sont ceux qui prennent pied dans la morphologie sociale locale, qui sont incarnés par des gens qui ressemblent au groupe majoritaire.
Benoît Coquard
C’est une leçon pour les normes écologistes qui elles ne sont pas incarnées par des personnes proches. Elles ne sont alors pas perçues comme légitimes parce que les catégories sociales qui portent cela, elles ne sont pas là dans les campagnes en déclin et elles n’ont pas envie d’y vivre. Quand ces catégories sociales vont vers le rural, c’est avant tout en direction des campagnes contemplatives où il y a déjà une plus grande sensibilité à l’écologie, une plus grande patrimonialisation de la nature.
Au risque d’une divergence grandissante entre ruralités ?
Il va y avoir des effets de polarisation entre des campagnes où on installera des sites d’enfouissement nucléaire et où on continuera d’avoir de grosses cultures industrielles, et d’autres ruralités où il y aura davantage de parcs nationaux, une accumulation de protection et de mise en œuvre de politiques écologistes. Comme le pays est en train de se polariser en termes de visions du monde, d’opinions politiques, on peut voir une évolution un peu à la manière des États-Unis où les lois de la Californie ne sont pas du tout les lois de l’Arkansas en termes de protection de la nature. Parce que cela répond à la population qui est sur place : en Californie vous avez davantage une population aisée qui est sensible à l’écologie, qui est favorable aux mesures de protection de l’environnement et dans les États de la Middle America vous avez davantage de ruraux qui, au contraire, sont très opposés à ça. Les lois sur l’avortement répondent à la même logique. Cela pose des questions sur la capacité à gouverner et fixer un cap pour l’ensemble d’un pays comme la France.
Il va y avoir des effets de polarisation entre des campagnes.
Benoît Coquard
Sur quel clivage s’appuie le RN ? Est-ce que vous pensez que c’est pérenne ?
Dans un territoire comme celui de mon enquête, ils se sont imposés depuis les années 90 et la désindustrialisation. C’est donc une dynamique au long court dans des territoires marqués par une absence de la gauche, où déjà le vote Mitterrand était faible. Ce n’est pas tant le RN qui s’est implanté, qu’une évolution de la droite. Une large partie de la population ici se disait déjà du côté des patrons. Il y a toujours eu plus d’un tiers de l’électorat ouvrier en France qui a voté pour la droite même au plus fort du Parti communiste. Le vote est juste passé de la droite classique vers l’extrême droite, sans que cela semble poser de problème moral. Typiquement mes enquêtés ouvriers fils d’ouvriers, leurs parents votaient pour la droite de gouvernement et eux votent pour l’extrême-droite et il n’y a pas de conflits dans les familles autour de ça, cela parait cohérent.
Les parents d’ouvriers votent pour la droite de gouvernement et eux votent pour l’extrême-droite et il n’y a pas de conflits dans les familles autour de ça.
Benoît Coquard
L’ancrage est profond parce qu’il est lointain, il renvoie à cette idée que c’est « bien » d’être de droite, on le dit en public, dans les conversations on se dit « 100 % Le Pen » pour dire justement qu’on n’est pas du côté des dits « cas sociaux », qu’on ne vote pas pour l’assistanat. C’est ce que disent tous les collègues qui travaillent sur le sujet, maintenant on commence à bien cerner les logiques de politisation par le bas et donc, pour moi, c’est une implantation qui est très forte pour l’extrême-droite parce qu’elle n’a même pas besoin de passer par des réseaux institutionnalisés. Il n’y a pas de militantisme d’extrême-droite visible, il y a même parfois du mal à trouver des candidats aux élections régionales. Néanmoins il y a des relais partout, notamment au sein des dominants locaux qui seraient une petite ou moyenne bourgeoisie à l’échelle nationale, qui ne seraient pas dominants à Paris ou dans les grandes villes. Avec l’absence très marquée des cadres des professions intellectuelles et supérieures, des diplômés qui, généralement, imposent leur vision du monde à d’autres catégories sociales, là c’est plutôt les petits patrons, les artisans, qui donnent le la en matière de politique parce que c’est eux les figures de réussite, les figures positives qui imposent leur vision du monde.
C’est plutôt les petits patrons et les artisans qui donnent le la en matière de politique, parce que c’est eux, les figures de réussite.
Benoît Coquard
Dans une perspective aussi très masculine parce que c’est plutôt des figures d’homme qui sont valorisés, en lien avec le fait que le marché du travail est beaucoup moins précaire pour le masculin que le féminin, qu’il y a plus de métiers masculins considérés comme valorisés que des métiers féminins. On valorise beaucoup moins le métier d’assistante à domicile que le métier de couvreur ou des métiers vus comme demandant un talent particulier dans la construction ou une prise de risque. C’est comme à l’échelon national où le secteur du care n’est pas du tout valorisé dans les salaires.
Depuis le mouvement des Gilets Jaunes, la question des inégalités en termes d’émissions et d’efforts à fournir face à la transition écologique s’est imposée. Dans le champ politique, on cible la responsabilité particulière des 1 %, de Bernard Arnault, etc. Est-ce que c’est un discours qui permet de renouer le lien avec une partie des classes populaires?
Sur le papier oui, après, mes enquêtés sont tellement éloignés de la gauche que ces messages ne leur arrivent pas forcément. On connaît les inégalités d’exposition médiatique des différents courants d’idées, ils ont peu de chances, même sur Facebook, tous leurs réseaux sociaux sont très cohésifs, ils suivent des gens qu’ils connaissent déjà, ça renforce plutôt la pensée déjà conformiste sur place. Et puis il y aurait un coût à sortir du moule. Un exemple que je prends tout le temps, c’est celui d’enquêtés qui disaient voter Le Pen en public et qui, en fait, me disaient qu’ils n’allaient pas voter, qu’ils n’étaient pas du tout convaincus par Le Pen mais qui le disaient pour ne pas être taxés de feignants.
Mes enquêtés sont tellement éloignés de la gauche que ces messages ne leur arrivent pas forcément.
Benoît Coquard
Il y a plutôt une forme de résignation chez les gens qui seraient à même d’écouter ce discours-là parce que, en amont, il y a tout un travail à mener pour recréer de la proximité sociale avec ce type de discours, pour l’incarner localement.
Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer le peu de prise de ce type de discours. Pourquoi ? Parce que les classes populaires adhèrent à l’idée qu’on peut être propriétaires, que les gens se construisent leur piscine. Même si le discours initial n’aura ciblé que les milliardaires, les figures conservatrices auront beau jeu de dire « toutes les personnes qui ont travaillé pour se payer une belle piscine n’auront plus le droit de la remplir », « parce qu’on a racheté la maison d’à côté pour la faire en Airbnb parce qu’on sait faire des maisons, on va payer la taxe sur les résidences secondaires », etc. Ces mécanismes de fausse conscience fonctionnent électoralement parce que c’est comme ça qu’on fait voter des programmes qui portent des mesures fiscales qui ne bénéficient qu’au 1 % mais qui sont votées par 60 % de la population. Les questions de propriété, d’héritage, de rapport au capital sont difficiles à faire bouger. Alors même que ces mêmes personnes ont tout à fait conscience d’être ouvrier, de faire un métier pénible, d’être « pris pour un con dans leur travail par leur patron » comme ils disent, de ne pas être assez valorisés, il y a d’autres sphères de la vie où cette fausse conscience sociale se déploie.
Il ne faut pas sous-estimer le peu de prise de ce type de discours. Pourquoi ? Parce que les classes populaires adhèrent à l’idée qu’on peut être propriétaires, que les gens se construisent leur piscine.
Benoît Coquard