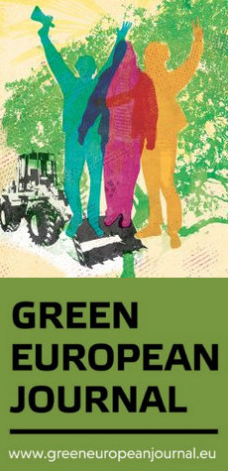Cet article est la version française d’un article paru sur le site du Green European Journal.
Il est accessible dans sa version anglaise ici: Questioning the Centrality of Work with André Gorz.
Le Green European Journal consacre un numéro spécial à la question de la transformation du travail en Europe intitulé Work on the Horizon. Tracking Employment’s Transformation in Europe à consulter sur le site du Green European Journal.
André Gorz, l’un des penseurs de l’écologie politique, doit également sa popularité à sa critique radicale du travail. Son exhortation, certes utopique, à « sortir du travail » nous offre l’occasion de réfléchir à ce que nous entendons par « travail » et à la place dominante que nous lui avons accordée.
L’invention du travail et la domination de la rationalité économique
En vertu de l’évidence selon laquelle nous nous sommes toujours affrontés à notre environnement pour produire notre subsistance, le travail est souvent appréhendé comme l’essence de l’homme, se réalisant de tous temps et sous toutes les latitudes. Pour comprendre les mutations actuelles du travail et envisager son avenir, mieux vaudrait pourtant l’appréhender dans son sens moderne, comme nous y invitait André Gorz.
Nos sociétés occidentales sont fondées sur le travail depuis une période relativement courte au regard de l’histoire humaine. L’essentiel des besoins était auparavant couvert par l’autoproduction dans le cadre de la famille et de la communauté villageoise à travers une diversité d’activités qui n’étaient ni évaluées ni échangées. L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme de Max Weber atteste du fait que, jusqu’à la fin du XIXe siècle, le travail de production matérielle obéissait encore largement aux us de l’économie domestique. Il s’agissait non d’un simple gagne-pain mais bien d’un véritable mode de vie régi par des traditions défiant la rationalité économique. Le paysan des cultures pré-capitalistes, l’artisan, l’ouvrier à domicile, tous ceux qui assuraient par eux-mêmes leur subsistance avec leurs propres moyens de production étaient en position d’autolimiter leurs besoins ainsi que l’intensité et la durée de leur travail. Or, avec le développement du capitalisme, ce lien direct entre production et consommation a été érodé. Nous avons perdu le contrôle sur l’une comme sur l’autre et sommes devenus des salariés-consommateurs : exposés aux puissantes stratégies publicitaires alimentant la spirale sans fin de nos besoins et désirs, nous dépendons – pour la plupart d’entre nous – du salaire de façon vitale.
À mesure que la production et la consommation marchandes perdaient leur caractère marginal, les tâches effectuées dans l’espace public sont apparues comme des prestations mesurables et rétribuées car elles avaient acquis une valeur d’échange. C’est la naissance du travail en général, ou « travail abstrait » selon Marx. En somme, le capitalisme a « inventé » le travail au sens moderne de « salariat » en le séparant de la vie dans laquelle les activités et les rapports humains n’obéissent ni aux valeurs productivistes ni aux règles de l’échange marchand. Ce travail salarié doit être distingué du travail au sens anthropologique ou bien philosophique, celui que l’on fait dans une variété presque infinie de formes et de métiers qui implique de peiner et/ou de créer. Ce travail-emploi marqué depuis plus de 40 ans, à des degrés divers selon les pays européens, par ce qu’on nomme « la crise du chômage» est bien une construction sociale. Ce n’est donc pas la nature de la tâche qui définit le travail et en fait une activité que Gorz qualifie d’ « hétéronome » mais son inscription dans la sphère marchande. L’activité de cuisiner, par exemple, est ou non du travail selon qu’elle est ou non effectuée contre paiement. Or, un nombre toujours plus grand d’occupations est considéré comme du travail au fur et à mesure de l’extension de la rationalité marchande.
Tout n’est pas du travail !
Il n’existait aucun désintérêt pour les conditions de travail de la part de Gorz. Il considérait au contraire qu’elles devraient être plus satisfaisantes et négociées en vue d’un meilleur équilibre entre travail et loisir ou, plus exactement entre emploi et travaux sans but économique, afin d’offrir à chacun une marge accrue d’autodétermination.
Il est incontestable que tout individu éprouve le besoin d’imprimer sa marque au monde environnant et de s’y réaliser. Néanmoins, tandis que cette dimension anthropologique du travail n’est jamais totalement absente de l’emploi, elle reste subordonnée à l’impératif économique (profit pour l’employeur, salaire pour l’employé) ; d’où cette « hétéronomie » irréductible. Les satisfactions personnelles (intérêt, plaisir, etc.) que peut éventuellement en tirer le travailleur ne sont que des buts secondaires, le premier étant de gagner sa vie. Surtout, toute autonomie dans le travail ne doit pas être confondue avec une autonomie plus large, existentielle, dont la défense depuis 50 ans constitue l’impulsion profonde de l’écologie politique de Gorz. La promotion d’une véritable autonomie suppose d’accepter d’interroger l’élargissement effrayant de la sphère marchande au détriment de la sphère non marchande. L’efficacité croissante des moyens de production économise, de fait, du temps de travail à l’échelle de la société, remarquait Gorz. Ceci est malheureusement d’emblée considéré comme opportunité d’une production plus importante de richesses marchandes en vertu du présupposé croissanciste sur lequel repose l’extension de la rationalité économique à des champs qui ne devraient pas en relever, comme on peut l’illustrer avec un domaine qu’il a particulièrement exploré:
Dans nos sociétés industrialisées, ne subsiste de la production domestique que les activités d’auto-entretien puisque, au terme d’un processus d’externalisation des tâches domestiques, le reste relève désormais des activités industrielles et marchandes. Or, la poursuite de ce mouvement consistant à absorber le plus possible de gens et de temps dans des services marchands sous des formes dégradées d’emplois est le symptôme patent d’une époque qui “gère” la diminution du volume de l’emploi avec l’acceptation tacite d’une forte aggravation des inégalités de statut et de niveau de vie. Les multiples livreurs de fast-foods, personnels de ménage et de soutien à domicile, etc. forment une masse de prestataires de services sous-payés – souvent à la disposition des débordés de travail mieux rémunérés. Or, cette externalisation n’aurait de sens que si elle libérait du temps à l’échelle de la société ; une économie fondée sur le développement extrême de l’échange mutuel de services n’a littéralement aucun sens et manifeste une complète irrationalité.
Cette terrifiante tendance à transformer en emplois et donc à monétariser des activités auparavant gratuites et autonomes constitue précisément ce qui avait motivé André Gorz à écrire son ouvrage Métamorphoses du travail. Quête du sens (1988). Il considérait que le développement vertigineux des services à la personne affecte notre capacité à nous prendre en charge nous-mêmes, affaiblissent notre autonomie existentielle comme le tissu relationnel qui nous nourrit. Ce modèle va en réalité à l’encontre des besoins profonds des individus de s’approprier leur corps et leur espace privé, sous forme du « travail pour soi » (soins aux enfants, cuisine, promenade du chien, ménage, etc.), comme de l’espace familier, informel et commun du village ou du quartier. Quant aux nombreux besoins véritables et négligés, tels que les soins aux personnes dépendantes, ils devraient relever systématiquement soit de services financés sur fonds publics (plutôt que de services marchands) soit être assurés par les gens eux-mêmes selon diverses formules d’aide mutuelle. Gorz prônait donc en ce domaine un système à deux piliers fonctionnant en synergie : d’une part, des systèmes institutionnalisés et, de l’autre, des systèmes auto-organisés coopératifs et bénévoles.
Pour une non-centralité du travail
Revenons au travail salarié en général. Avec la globalisation et l’intensification de la division du travail qu’elle implique, le travail sous sa forme emploi est incontestablement toujours plus central au niveau planétaire parce qu’il concerne de plus en plus d’activités humaines et devient activité obligée de survie pour le plus grand nombre. Cependant, cette augmentation du nombre d’emplois salariés ainsi que la montée d’une classe moyenne dans les pays ayant « émergé » ne devrait pas conduire à ignorer l’expérience traumatique de masses importantes de populations concernées par la déruralisation et la prolétarisation avec urbanisation sous des formes dégradées. On ne peut non plus passer sous silence le caractère structurel d’un taux de chômage mondial entre 5,5 et 6% depuis une décennie ni la proportion importante d’emplois qualifiés pudiquement de « vulnérables ». Même si l’impact des technologies numériques sur l’emploi est sujet à de vives controverses, il y a lieu de s’interroger sur l’imposition du modèle salarial comme forme d’organisation sociale.
Pour ce qui est des travailleurs européens, on constate que le travail gagne également en centralité (négative), au sens d’un développement de la rationalisation de la vie quotidienne. Paradoxalement, avec l’exigence d’une implication personnelle croissante, tandis que diminue le temps de travail rémunéré, le temps réellement travaillé augmente souvent, par exemple à la faveur des technologies numériques qui permettent d’être sollicité et/ou de travailler hors de l’entreprise. Par ailleurs, le travail reste garant de droits et de statuts, ainsi que source d’identité et d’intégration sociale. Nous vivons encore dans une culture du travail. Pour autant, le rapport salarial perd progressivement ses protections statutaires et est marqué par une précarité et une discontinuité croissante ; à tel point que l’emploi constitue de moins en moins le point d’ancrage à partir duquel on puisse construire son existence. Il remplit de plus en plus difficilement ses fonctions structurantes, dégagées dès la célèbre étude de 1930 sur les chômeurs de Marienthal en Autriche par l’équipe de la sociologue Marie Jahoda. Elles incluent une expérience et un objectif partagés, un temps structuré et une activité régulière. Gorz l’exprimait avec lyrisme dans Misères du présent, richesse du possible (1997): « Le travail ne conserve qu’une sorte de centralité fantôme au sens où l’amputé souffre du membre fantôme qu’il n’a plus. Nous sommes une société de travail fantôme survivant fantomatiquement à son extinction grâce aux invocations obsédantes, réactives de ceux qui continuent d’y voir la seule société possible et ne peuvent imaginer d’autre avenir que le retour du passé».
En résumé, les tendances actuelles – globales comme européennes – pointent vers l’épuisement de ce modèle salarial et militent en faveur de son dépassement. Comme tel, non seulement il doit mais peut être dépassé. Insistons encore sur ce dernier point: La source majeure de l’identité sociale demeure aujourd’hui le travail salarié, non pas un invariant anthropologique. Autrement dit, ce travail n’est pas en soi intégrateur mais il l’est parce qu’il est la forme historiquement déterminée d’intégration sociale de notre société. Ne croyons pas qu’il soit le porteur par excellence, voire même l’incontournable porteur de ces fonctions d’identification et d’expression individuelles et collectives. Pour l’heure, l’insistance sur la centralité du travail dans la vie de chacun fonctionne de fait comme une stratégie de domination : l’injonction à se gérer comme une marchandise en quête d’un acheteur toujours plus exigeant. Dans ce contexte, il serait logique de faciliter identification et expression dans des activités alternatives, moins prescrites, de la vie quotidienne. « L’abolition la société salariale » reviendrait alors, comme l’expliquait Gorz, à mettre fin à « la tyrannie qu’exercent les rapports de marchandise sur le travail».
Critique du dogme de la croissance, remise en question du salariat comme mode d’organisation sociale, invitation à promouvoir l’épanouissement des individus grâce au développement des activités de nature autodéterminée, corrélative de la revendication d’une diminution du temps passé à un travail hétéronome: toutes ces exigences sont indissolublement liées. Alors que les individus atomisés des cités modernes, manquant de temps, de place et d’autres ressources, sont de manière croissante pris en charge par l’État et le marché — et souvent demandeurs d’une telle prise en charge — se délite la « société civile » entendue comme tissu de relations de coopération et d’entraide établies volontairement et hors médiation institutionnelle. Pourtant l’autonomie n’est pas seulement un besoin privé mais également un but collectif : produire des communautés dans lesquelles le lien social n’est pas de manière prédominante un lien marchand.
Pour une vraie politique du temps
Contre cette centralité fantomatique du travail, la réponse gorzienne, préconisée tout d’abord au niveau européen, à l’impératif de poser des limites à la marchandisation du monde consistait en une triple revendication : mise en place d’un revenu d’existence associée à des politiques volontaristes de réduction du temps de travail et à des mesures favorisant l’extension des espaces d’activités autonomes/non marchandes. Le retour actuel de débats et scenarios sur l’instauration de la garantie du revenu (découplage entre tout ou partie de la protection sociale et la participation au monde du travail salarié) est bienvenu, mais l’envisager isolément d’autres politiques – sociales, urbaines, éducatives, etc – ne garantit nullement qu’il représente une issue émancipatrice. D’autre part, si les propositions de création de Green Jobs (restaurateurs de cohésion sociale et de nature et répondant à des besoins plutôt qu’à des demandes marchandes) sont évidemment à saluer, il y a également nécessité d’une véritable politique du temps qui ne se borne pas à réduire le chômage. Enfin et surtout, le maintien coûte que coûte de l’idéologie de l’emploi pour l’emploi et de l’éthique du travail résulte d’un choix éminemment politique. Or, la politique ne doit pas se concevoir d’abord comme politique de l’emploi.
Ceci allait de soi dans la foulée de mai 1968 lorsqu’on s’essayait à « changer la vie », avec le soutien d’un syndicalisme libéré d’une identification complète avec le monde du travail comme l’était par la CFDT française des années 1970; une impulsion laminée par une quarantaine d’années de néolibéralisme et de « crise ». Alors que le travail pèse de plus en plus sur l’existence, les écrits d’André Gorz demeurent précieux. Ils exigent de penser autrement sa fonction et son sens et, plus largement, de « déséconomiser » les mentalités ; ce qui n’est pas une mince affaire tant la tradition ouvrière a mené une critique du capitalisme du point de vue du travail, ses intellectuels et militants s’étant dans leur majorité trouvés réunis dans le culte de la Production et du Travail, source passée de tous les messianismes. En revanche, Gorz nous invitait à promouvoir une société du temps libéré, une Kulturgesellschaft (société de culture) comme on l’appelait dans la gauche allemande très avancée sur ces questions dans les années 1990, par opposition à notre « société de travail » ou Arbeitsgesellschaft, en cohérence avec la mise en question de l’orientation productiviste toujours dominante.
Aujourd’hui pourtant, de jeunes universitaires britanniques reprennent son mot d’ordre d’autonomie et, plus généralement, avec le ‘post-work’ debate nous assistons aux frémissements d’une discussion critique visant à sortir la gauche de sa torpeur en la matière. Si cette interrogation parvient à émerger au Royaume-Uni et outre-Atlantique où les politiques économiques et sociales ne se distinguent pas par leur progressisme, il est alors permis de ne pas désespérer du reste de l’Europe. Dans ce contexte, les écologistes ont une mission claire : énoncer des propositions novatrices en rupture avec le consensus.
 François Gollain est docteur en sociologie et spécialiste de la pensée d’André Gorz qu’elle a bien connu. Ses recherches portent sur l’écologie politique, la critique du travail et du consumérisme. Elle a été membre du comité de rédaction de la revue Entropia. Enseignante associée à l’Open University, elle vit entre la France et le pays de Galles.
François Gollain est docteur en sociologie et spécialiste de la pensée d’André Gorz qu’elle a bien connu. Ses recherches portent sur l’écologie politique, la critique du travail et du consumérisme. Elle a été membre du comité de rédaction de la revue Entropia. Enseignante associée à l’Open University, elle vit entre la France et le pays de Galles.
Elle vient de faire paraitre l’ouvrage André Gorz. Une philosophie de l’émancipation (L’Harmattan, 2018).