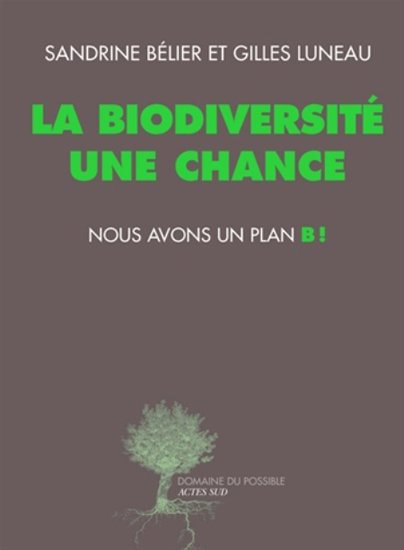La biodiversité, une chance. Sous ce titre, Sandrine Bélier (juriste, militante associative, ancienne directrice fédérale de France Nature Environnement, députée européenne EELV depuis 2009) et Gilles Luneau (rédacteur en chef de GLOBALmagazine) s’entretiennent sur le vivant, sa diversité et les menaces qui l’affectent, et présentent leur Plan B(iodiversité) pour y faire politiquement face. {Les premières pages de l’ouvrage sont consultables en ligne: http://www.actes-sud.fr/sites/default/files/9782330025809_extrait.pdf}
L’exposé de ce plan fait suite à deux constats alarmants: l’un est scientifique, l’autre est politique.
Biodiversité: le terme a été introduit en 1986, à Washington, lors d’un congrès de biologie de la conservation, discipline scientifique nouvelle qui avait la vocation de préserver ce qu’elle étudiait. Le terme de biodiversité qui désigne l’ensemble du vivant, à ses différents niveaux (génétique, spécifique, écosystèmes et paysages) apparaît alors même que ce qu’il désigne est en danger. C’est une alerte en même temps qu’un constat: on parle de crise d’extinction, qui serait la sixième depuis les débuts de la vie, mais la première dont les actions humaines sont responsables. Ce sont ces menaces sur la biodiversité (dégradation des habitats naturels, disparition accélérée d’espèces) que Sandrine Bélier et Gilles Luneau présentent, à partir des nombreux rapports scientifiques qui les ont établis, et en les replaçant dans l’ensemble d’un Système Terre fortement affecté par les conséquences nocives des actions humaines (pollutions diverses des airs, des eaux et des sols).
On ne peut donc pas dire que l’on ne sait pas, ni que l’on ignore les remèdes: ces constats scientifiques sont des diagnostics qui indiquent des mesures à prendre. Mais ces mesures ne sont pas prises, ou insuffisamment. La biodiversité est une question politique parce que, aussi bien par le type de problèmes posés (notamment sociaux) que par leur ampleur (c’est notre mode de développement et nos façons de vivre qui sont en cause), faire face aux menaces requiert une mobilisation citoyenne générale (au-delà des spécialistes directement concernés) et engage, à différents niveaux (local, régional, national, européen, global ou international), des politiques publiques qui ne peuvent être simplement sectorielles. Or, deuxième constat alarmant: la volonté politique fait défaut, de nombreux dirigeants sont dans le déni. Cependant ce déficit politique est inégalement réparti. Les scientifiques et de nombreux militants associatifs sont mobilisés, la société civile est en avance sur des institutions politiques défaillantes. Mais, là aussi, il faut différencier suivant les niveaux. S’il existe de nombreuses réglementations internationales, l’absence de ce qu’on appelle une gouvernance internationale en rend l’application problématique, alors qu’au niveau européen, il existe des directives qui peuvent être le cadre d’actions communautaires. Mais c’est le relais national qui ne suit pas. Tout particulièrement en France, avec un gouvernement français plusieurs fois condamné (et qui risque encore de l’être), pour non conformité aux normes, ou absence de mise en oeuvre d’un plan, ou qui soutient, au large de la Guyane, une exploitation du pétrole qui met en grand danger le trésor de biodiversité de ce pays. Sandrine Bélier souligne plusieurs engagements militants (contre les OGM et pour les semences paysannes, contre les gaz de schiste, contre le projet d’aéroport à Notre Dame des Landes) qui ne rencontrent guère d’écho dans la politique gouvernementale (quand elles ne vont pas à contre courant de celle-ci).
Il reste donc à déterminer ce qu’il faut faire: le plan B. En commençant par rappeler tout ce qui a déjà été fait, et continue de l’être, au niveau local, régional et militant. Sandrine Bélier relate son expérience de militante en Alsace, mais aussi dans d’autres régions: actions qui mettent en rapport militants associatifs, responsables territoriaux, scientifiques et techniciens et qui débouchent souvent sur des succès. Qu’il soit question du loup ou de la défense d’une forêt, il s’agit de réinventer le développement des territoires ruraux en s’appuyant sur les associations environnementalistes ou écologiques. Elle relate aussi l’intégration des entreprises dans une responsabilité sociale et environnementale qui n’est pas toujours un déguisement publicitaire mais s’accompagne parfois d’un réel changement des pratiques. Sandrine Bélier insiste enfin sur l’importance qu’il y a, pour l’action, à disposer d’un ensemble de règlementations et de directives (notamment européennes) où elle voit des ‘outils’ utiles pour encadrer des comportements favorables à la biodiversité. Chargée au Parlement européen du rapport sur la ratification du protocole de Nagoya (2010), elle donne des éléments d’information importants sur cet accord qui montre une avancée de la coopération mondiale sur la biodiversité.
Reste donc le point central: l’absence de volonté politique au niveau national. Si le Grenelle de l’environnement a pu représenter, pour Sandrine Bélier, un moment intense, éprouvant mais constructif, de rencontre entre les différents acteurs environnementaux, cette unité s’est évanouie. Comment insuffler aux politiques une volonté (de résister aux intérêts particuliers, de se débarrasser de leurs convictions productivistes) qui leur fait défaut? En leur tenant un langage qu’ils entendent, en leur expliquant que le vivant n’a pas de prix mais que sa perte a un coût, que, plus on attend, plus ce coût s’élève et que ce coût n’est pas seulement un coût puisqu’il peut donner lieu à des emplois nouveaux. C’était déjà la teneur du rapport de Nicolas Stern sur le changement climatique. Le même discours, tenu sur la biodiversité, aura-t-il plus d’effet? Cela suppose en tout cas de développer une évaluation économique de la biodiversité, au centre de laquelle on trouve l’évaluation des services écosystémiques lancée par le Millenium Ecosystem Assessment et déclinée depuis dans de nombreux rapports.
Or ce type d’évaluation fait actuellement débat parmi tous ceux qui s’intéressent activement, comme Sandrine Bélier et Gilles Luneau, à la biodiversité. On peut s’inquiéter qu’en passant de la biodiversité aux services écosystémiques, on réduise la diversité à la seule fonctionnalité (et on perde la redondance) et que l’on ne retienne de la fonctionnalité que la seule utilité pour les hommes, comme si toute la nature n’avait été faite que pour eux. On peut aussi se demander si, tout en affirmant que la nature n’a pas de prix, ou qu’il ne s’agit pas de monnayer la vie, mais de s’interroger autant sur la nature de la valeur que sur la valeur de la nature, et, en évaluant, même de façon virtuelle, les services écosystémiques, on ne fait pas entrer un peu plus complètement la biodiversité dans un système économique qui est pour beaucoup dans son érosion actuelle. À la façon dont, dans la Convention de Rio sur la diversité biologique (1992), la transformation de celle-ci (dont on déclarait la valeur intrinsèque) en ‘ressources génétiques’ (des avantages desquelles on souhaitait le partage équitable) a conduit à une exploitation marchande de la biodiversité et à un développement de la brevetabilité du vivant qui n’a guère profité aux populations qui étaient censées en retirer des avantages, on peut craindre que l’évaluation des services écosystèmiques n’aide pas à rétribuer ceux qui contribuent à leur existence, et que, bien loin d’être enrayée, l’érosion de la biodiversité se renforce.
Le choix n’est pas seulement entre faire et ne pas faire, il est entre diverses façons de faire dont certaines ne font qu’accélérer le processus redouté, en faisant croire que l’on s’en occupe. Cela se joue aussi dans les mots. Sandrine Bélier se présente comme ‘avocate de la nature’, car, remarque-t-elle, ‘les gens ne disent pas: ‘je me bats pour la biodiversité » (p. 114). Le mot de biodiversité a eu très vite du succès (introduit en 1986, il est d’usage courant dès 1988). Cela tient à ce qu’il s’agit d’un mot militant, qui traduit l’engagement des scientifiques, leur rôle de lanceur d’alerte. Mais cela tient aussi à ce qu’il s’agit d’un mot transdisciplinaire, un ‘mot de passe’ entre le monde de la science, le monde de la finance et celui de la politique. Les politiques (à la différence des militants associatifs) se souciant plus de la biodiversité que de la nature, les biologistes ont l’espoir, avec la biodiversité, d’acquérir un rôle dans la gestion politique de la biodiversité (sa gouvernance). C’est à cet espoir que la création, sur le modèle du GIEC, d’un organisme mondial de la biodiversité, l’IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), peut répondre en organisant le lien, qui fait problème, entre savoir scientifique et volonté politique. Mais comment ce lien s’effectuera-t-il? Le risque est que s’établisse, des scientifiques aux corps d’État spécialisés, et aux ingénieurs et aux techniciens opérationnels, un continuum de monopolisation du savoir, des pouvoirs de décision et de la mise en oeuvre pratique, qui soit d’abord soucieux du renforcement de son pouvoir et dont les pratiques soient opaques à ceux qu’elles concernent. La biodiversité alors, de mot militant, ne serait plus qu’un substitut technocratique de la nature, établissant avec celle-ci un rapport gestionnaire, où comptabiliser c’est toujours dominer.
Catherine Larrère est présidente du Conseil de surveillance de la Fondation de l’Ecologie Politique