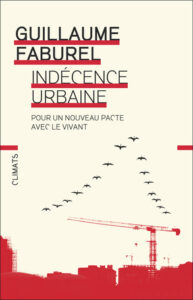De récents épisodes – pandémie, canicules – ont donné un nouvel écho à la question de l’insoutenabilité des Métropoles. Le rapport « Paris à 50°C » a marqué les esprits en 2023. Dans votre dernier ouvrage, vous soulignez une envie de changement de la part des habitants de ces espaces là. Sommes-nous entrés dans une nouvelle période politique ?
Guillaume Faburel : Période politique, je ne sais pas car si le militantisme écologique urbain est croissant et que les actions métropolitaines de la gauche écologiste se veulent volontaires, cela ne changera pas fondamentalement la situation écologique des grandes villes. Toutes les données sont très claires, qu’il s’agisse de rafraîchissement par végétalisation ou d’autonomisation par l’agriculture urbaine, notamment. Plus encore, cela laisse espérer un changement, alors même que vivabilité et autonomie sont inatteignables avec de telles tailles de ville, de plus en plus converties à des concepts florissant – tel celui de Ville du quart d’heure qui n’est autre qu’un concept de citadelle. En fait, la logique d’attractivité et de croissance prévaut encore largement, mais convertie à l’écologie (ex : le tout vélo, le tout bio et le tout éco : -quartier, -cité, -musée…). Personne ne considère la métropolisation des 50 dernières années comme le problème d’entrée.
Par contre, socialement il semble bien y avoir un mouvement à bas bruit si l’on en juge le déplaisir croissant des populations urbaines vis-à-vis du béton et de l’artificialisation, y compris dans les classes populaires (nous y reviendrons sans doute). Entre épuisement des corps et saturation des vies, la densité est de plus en plus mal vécue et ce depuis la période inaugurale de la dite métropolisation justement. Les volontés de changement d’habiter semblent s’affirmer, mais bien d’avantage que dans l’offre politique. De là à dire que de nouvelles subjectivités vont devenir politicités (au sens donné par Denis Merklen de double exigence de « survie » et de « citoyenneté »), cela reste à prouver. Pourtant, il va bien falloir modifier radicalement notre habiter et ce faisant rétrécir les villes. Changer d’ère politique signifie clairement changer d’abord d’air et d’aire géographique. Sous quelques conditions environnementales et sociales, il va sans dire.
Le temps où la marginalisation des ruralités était synonyme de progrès semble révolu, Du moins dans les esprits . Mais au moment de redonner une place centrale aux ruralités dans les imaginaires, on voit surgir le risque de pensées identitaires de la démétropolisation. Pour contrer cela, vous proposez de sortir de la relation dialectique entre options progressistes et réactionnaires pour ouvrir une autre écologie politique. C’est à dire?
La dialectique progrès-conservation s’est construite sur la base d’une autre dialectique, assez vite mise de côté dans les pensées de l’écologie : la dialectique urbain-rural du modèle centre-périphérie et de la colonialité intérieure. Plus que toute autre, elle incarne le grand partage Nature-Culture de la modernité, que l’on retrouve dans les termes promus d’un côté (terroir, racine, pays…) et clairement brocardés de l’autre. « On ne peut être progressiste si on ne reconnaît pas le fait urbain et la disparition des sociétés rurales » disait non sans morgue le géographe Jacques Lévy en 2018 dans Libération.
Toutefois, dans les écologies en concurrence, seule l’écologie de la suffisance et de la subsistance pourraient peut-être inverser la tendance des méfaits du productivisme urbain et de la croissance. Seules l’autolimitation et donc l’autonomie au plus près des ressources de vie pourraient, par nécessité d’attention et de précaution à la régénération, réduire sérieusement empreintes et ponctions. « L’autonomie – la vraie liberté – est l’autolimitation nécessaire non seulement dans les règles de conduite intrasociale, mais dans les règles que nous adoptons dans notre conduite à l’égard de l’environnement » nous disait Castoriadis dans « La force révolutionnaire de l’écologie »[1].
Dès lors, le mouvement progressiste va devoir revenir à la source des ruralités (et à par là même à Charbonneau et Illich, à Lambert et Gévaert…). Et, on ne va pas se cacher, cela va être compliqué car, pour reprendre l’une des définitions selon moi les plus signifiantes de l’écologie, celle donnée par André Gorz, l’écologie c’est « le souci du milieu de vie en tant que déterminant de la qualité de la vie et de la qualité d’une civilisation ». Sans caricaturer, les tensions ont déjà commencé entre chasseurs et cyclistes, entre pratiquants de la chimie de synthèse et permacultrices/permaculteurs.
Or, sans angélisme aucun, il y a bien de quoi se rencontrer. Faire autonomie et vivre de peu ne sont pas inconnus dans les ruralités. Tout cela sans même parler du fait que toutes les ressources de subsistance y sont localisées. Comme le décrit Erwan Ruty[2], les métiers de la main servent d’économie populaire et, comme l’analyse Fanny Hugues dans ses travaux, la débrouille y redessine des solidarités populaires de proximité[3]. Voilà pour des communs qui ne seraient pas sans faire lien. Mais si l’on reste enfermés dans la construction historique de cette partition géographique, point de salut face au risque fasciste qui représente selon moi le miroir inversé de ces dialectiques enchâssées, en France comme ailleurs.
Que faire ? Tout d’abord, il y aurait sans doute à allier, sous l’égide de l’autonomie justement, certaines des subalternités, celles auxquelles on s’en est remis pour exécuter les tâches nécessaires à l’abondance et à la jouissance, à la délivrance matérielle et à l’opulence… urbaines : depuis les paysanneries et leurs savoir-faire jusqu’aux ruralités communautaires, mais également depuis les quartiers populaires[4] jusqu’aux ronds-points solidaires[5] – que les politiques d’Etat au mieux dégoutent de l’écologie au pire éloignent, pour des raisons non moins sécuritaires, de la subsistance. Elles ont été historiquement dépouillées de leurs propres cultures écologiques et souvent de leurs propres habiter de la terre, mais, et là est la possibilité, ont appris du déclassement la nécessité d’autoproduire par le local et, parfois encore, le rapport non propriétaire à la terre.
Dans ce dessein, pour commencer, il conviendrait de se réapproprier certains mots, qu’il s’agisse du pays (géographique), des traditions, des racines ou encore des terroirs. Selon Ernst Bloch, philosophe proche de l’École de Francfort, si le fascisme a triomphé lors de la seconde guerre mondiale c’est qu’il a réussi à satisfaire des désirs d’enracinement que le communisme urbain et productiviste était incapable de prendre en charge[6]. Bien des mots sont restés en jachère dans les pensées de gauche, mots qui d’ailleurs, remarquons-le, ont tous des signifiés originaires du vivant, qu’il s’agisse des racines ou de la terre. Rappelons pourtant qu’humanité, humus et humilité partagent la même racine latine.
En fait, le « pays » n’est pas délié des vies paysannes, la tradition peut aussi faire révolution, les terroirs peuvent aussi faire progrès et qui ne voit pas qu’être radical c’est revenir à quelques racines. Plus qu’origine et identité instrumentalisées par les pensées réactionnaires et identitaires, il y a là des intensités et attachements au fondement de sentiments que l’on retrouve notamment dans le vote RN : sans doute l’abandon mis largement en avant dans les débats mais surtout, suivant en cela Félicien Faury, la dépossession et la blessure de formes de vie et cultures[7]. Je renvoie à la dernière Note du Mouvement post-urbain sur ce thème précisément, en ligne sur le site (www.post-urbain.org) : « Le vote rural RN dans les pensées métropolitaines ».
La question du déménagement du territoire pose la question de l’accueil. Vous défendez l’idée dans Indécence urbaine (Climats-Flammarion) que ceci est possible et surtout nécessaire pour tisser d’autres rapports aux vivants. Comment pourtant ne pas reproduire les formes d’exploitation, d’injustices et inégalités ?
Ce sont des risques à n’en pas douter. Mais, je rappellerais que les ruralités sont de longue date faites à la main des modes de vie urbains. Hectares fantômes comme esclaves énergétiques ont invisibilisé tout ceci, depuis les villes grossissantes et leurs modes de vie surplombant. Dès lors, certes, nombre sont celles et ceux qui, en partant, reproduisent les styles de vie métropolitains : leur manière de consommer les lieux, leurs sociabilités triées, leurs professionnalités tertiarisées, ou encore leurs loisirs de fin de journée. Ainsi que le clamaient en 2020 Caryl Férey et les sœurs Chamots au Salon du livre d’expression populaire et de critique sociale à Arras : « Pachamama nous a mis la fessée, mais tu la veux coûte que coûte la 5G ».
Cependant, évoquer le risque d’inégalités c’est omettre que la subsistance peut grandement lutter contre la marchandisation et la propriété. En outre, on constate depuis les espaces périurbains notamment, ou encore depuis des professions tertiaires sur lesquelles on n’aurait pas misé écologiquement, un affranchissement lent de certaines des dépendances métropolitaines par l’éloignement, qu’il s’agisse de pratiques culturelles ou de consommation alimentaire. En fait, qui fait fondamentalement œuvre de colonialité, du vivant notamment ? Les nouveaux installés ou ceux qui poussent à toujours plus vivre dans les espaces bétonnés en voulant toujours plus y construire pour prétendre répondre à la crise du logement en sacrifiant l’écologie ? Chacun se fera une idée, mais il semble bien que l’on trouve aussi dans les départs des motivations environnementales un peu plus clairvoyantes. Un désir d’autonomie et de sobriété notamment. Ne serait-ce pas là aussi une question de justice ?
Et ceci n’a rien d’étonnant : contrairement à ce que la seule lecture sociologique indique trop souvent, là où nous habitons, c’est-à-dire nos géographies de vie, façonne aussi de beaucoup le regard porté sur le monde, et ce depuis le foyer jusqu’au grand paysage. L’environnement que l’on habite modèle grandement les pensées. C’est une évidence. Or, si la crise écologique est une crise de sensibilité, difficile d’avoir une culture du vivant dans un bureau devant son écran. Romantisme bourgeois de la nature ? D’après l’Union sociale pour l’habitat, 18 % des membres du parc HLM déclaraient en 2019 être intéressés, aussi pour des raisons écologiques, par des modes d’habiter autosuffisants basés sur la recherche d’autonomie énergétique et alimentaire. Sans doute pour mettre aussi un peu à distance certaines relations de domination. D’ailleurs, même les pensées des plus installées commencent à admettre que les profils des nouveaux ruraux sont divers, avec ce qu’elles dénomment des « marginaux », mais également non sans morgue « antivax », « éco-anxieux », « individualistes », et avec relativisme des « bac + 5 », une « clubbisation » et une « gentrification ». Voilà en fait pour la colonialité historique… des pensées urbaines du monde.
Le mouvement post-urbain défend l’idée que l’avenir de l’humanité ne pourra se jouer que dans les ruralités. Quelle place toutefois dans cette bataille politique pour celles et ceux qui pensent que le freinage et la décroissance des métropoles peut et doit aussi se faire depuis les Métropoles ?
De prime abord, vivre dans une métropole offre quelques opportunités. Déjà se convaincre, par l’expérience, de la nécessité écologique et sociale de la transformer. Et ce n’est pas rien. La dégradation rapide des conditions environnementales de vie comme la conversion néolibérale des existences aident grandement à réfléchir autrement, à se projeter différemment. En outre, cela permet de se socialiser politiquement par la densité, de faire solidarité politique par la proximité, de faire expression politique par le nombre rassemblé. Tout ceci pour alors s’employer à faire évoluer l’existant, que ce soit le vivant dans les espaces restés en friches ou la réaffectation de bureaux et logements, notamment. Il s’agirait également, puisque véritables mines à ciel ouvert, de suivre quelques institutions nationales qui, telle l’Agence de la Transition écologique (ex ADEME), indiquent que l’ensemble des toitures urbaines seraient amplement suffisantes pour satisfaire les besoins d’électricité dans les grandes villes. Enfin, et plus encore, tels que s’y emploient des mouvements (avec les réactions policières de l’Etat autoritaire que l’on connaît), c’est de ce dedans que le démantèlement par dé-bétonnage et fermeture des activités nocives peut être posé. On est là de plein pieds dans les trois leviers mis en avant par Erik Olin Wright, dont l’ouvrage posthume est très en vogue dans les milieux militants urbains de gauche[8] : la rupture par voie insurrectionnelle, des stratégies symbiotiques qui luttent de l’intérieur de l’État, et agir à partir du bas, par l’ordinaire des pratiques, là où la vie et la production s’organiseraient de manière encore non capitaliste.
Toutefois, tel que le décrit dans les Métropoles barbares, si l’on peut émettre quelques doutes concernant l’existence de telles situations « non capitalistes » tant à l’ère néolibérale ville et capitalisme ont atteint le stade de la symbiose, on peut a fortiori s’interroger sur le fait de prétendre faire écologie en s’abstrayant à ce point des milieux nourriciers assurant notre propre subsistance ? Par ailleurs, peut-on prétendre défendre la justice écologique en participant même involontairement des mécanismes de surenchérissement immobilier en y résidant ? « La conscience d’être un élément d’une force hégémonique déterminée (c’est-à-dire la conscience politique) est la première étape pour arriver à une progressive auto-conscience où théorie et pratique finalement s’unissent » disait Gramsci[9]. De toute façon, la descente énergétique et la compression matérielle vont conduire au rétrécissement. Et cela va être de plus en plus violent. Je serai donc d’avis de surtout anticiper le « déménagement » du territoire, pour reprendre en l’adaptant une proposition éloquente faite dès les années 1960[10]. De s’opposer à la métropolisation totale du monde, à la nouvelle vague d’exurbanisation du capital, au nouveau sacrifice des campagnes… en y ouvrant des zones refuges au plus près des ressources vitales, le tout sans oublier personne à l’enfer du béton.
C’est ce à quoi s’emploient des alternatives communautaires comme des initiatives d’échelles intermédiaires qui, c’est à remarquer, souvent composées de militants venant des grandes villes justement, maillent une bonne partie des périphéries du territoire hexagonal. Elles œuvrent à des parentés et communautés de destin susceptibles de rassembler les différents colonisés dans un combat unifié[11], à l’exemple de ce que des communautés historiques (cf. Longo Maï), des coopératives intégrales (cf. du Berry notamment), ou encore des initiatives territoriales ont engagé : Syndicat de la montagne limousine, Communauté Emmaüs paysanne de la Roya, Université rurale des Cévennes… Le tout sans omettre, bien au contraire, accueil, hospitalité et multi-culturalité.
Pour offrir une perspective, vous appuyez sur le concept de biorégions et mettez en avant des situations de création d’autonomie par le bas et proposez une stratégie d’insoumission archipélique. Dans un pays comme la France où l’État demeure puissant, quels interstices existent pour créer de l’autonomie politique qui laisserait sa place à l’ensemble du vivant ?
Ces interstices sont de multiples natures, et je renvoie à Indécence urbaine. Pour un nouveau pacte avec le vivant pour le détail (2023, Climats-Flammarion). Ils croisent toutefois toujours a minima autosubsistance et autogestion.
Pour la subsistance alimentaire, nous savons que les écosystèmes vont, sur l’arc ouest européen, remonter peu ou prou de 500 kms, mais, en croisant les données, certains espaces vont conserver de belles potentialités, notamment le trio « Limousin-Corrèze-Creuse-Cantal-Lozère-Nord Aveyron-Nord Lot », « cœur Bretagne » et « centre des Pyrénées », de même que les espaces enceints dans ce triangle. Pour le logement maintenant, au premier chef vacant, la vacance est particulièrement importante dans ce que nous avons dénommé dans le cadre du Mouvement post-urbain la République des 50 000. Cette maille unifie petites villes de proximité, bourgs, villages et hameaux, et est pour partie lovée dans la chatoyante « diagonale du vide », en partie née de la macrocéphalie parisienne du siècle écoulé ainsi que de la digestion métropolitaine des arrière-pays. Et pour les déplacements, c’est sans doute à l’échelle de Communautés des 30 000 à 40 000 (habitant.es) que le ralentissement pourrait se réaliser : de 20 à 30 kms de diamètre pour la mise en place de mobilités moins carbonées, et pour les métiers émanant des cultures paysannes et artisanales attachées aux habitudes sociales et culturelles des lieux, y compris les festivités et leur convivialité.
Plus largement, de tels interstices sont des milieux tels que des petites vallées et plaines, des fragments de plateau et moyennes montagnes. Ils s’incarnent encore, dans la suite de ces cultures, par quelques institutions, elles-mêmes largement subalternisées dans l’arrangement politico-administratif : foyers ruraux et centres sociaux, Parcs naturels régionaux et pays géographiques notamment (ces derniers ayant convertis en Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux pour être fusionnés). Mais il y a aussi au titre des actions et acteurs, par exemple, les éco-lieux et écovillages, dont le nombre dépasse maintenant le millier en France, à plus de 90 % dans les ruralités (toutes les régions étant peu ou prou concernées). De même que toutes les initiatives communautaires et intermédiaires évoquées précédemment. Enfin, plus important sans doute, remarquons ici que les territoires ruraux dans lesquels ce foisonnement s’opère sont ceux véhiculant historiquement des cultures autonomistes régionalistes (Lozère et Cévennes, Pays basque et Bretagne, Limousin ou encore Savoie). Ici, le confédéralisme démocratique nourrit beaucoup de pensées et de velléités.
C’est sur cette base multiple que des biorégions post-urbaines pourraient ouvrir de nouvelles mailles territoriales[12], à la fois pour préparer le déménagement évoqué et allier les subalternités. Cependant, vues les propensions très métropolitaines à détourner la notion et l’insérer dans la mondialité, y compris parfois depuis des pensées se réclamant pourtant de la radicalité, d’autres formes politiques pourraient également venir incarner la réalisation de la géographie proposée. Pensons au Chiapas éco-socialiste notamment. Et, avec 4000 m2 par habitant, c’est-à-dire ce que nous avons là aussi dans le cadre des réflexions sur le Post-urbain dénommé en Cité des 4000 (moyenne requise pour faire autonomie par personne), il y a bien la place hexagonale nécessaire de se relocaliser de manière déconcentrée et décentralisée. Avec moindre artificialisation que ce qui existe aujourd’hui (agriculture industrielle comprise) !
Les 14, 15 et 16 juin dernier s’est tenu l’An III du Post-urbain en cœur Bretagne. Quelles sont les prochaines échéances pour la société écologique du post-urbain ?
Après l’An III sur Les joies de l’autonomie et de ses communs. Autosubsistance et autogestion dans un monde post-urbain qui a réuni trois jours durant 140 personnes, l’objectif des prochains temps avec les vingt organisations, dont la FEP (et de nouvelles arrivantes), est de penser plus directement les débouchés politiques et plus encore d’écologie politique du Post-urbain, et ce à la suite de la mise en débat des trois premières années.
A cette fin, nous avons depuis lors mis en place en août dernier un Parlement des écolieux avec la coopérative Oasis, organisé un moment de rencontre entre artistes et paysans en Lozère en octobre sur les Subalternités et milieux vivants dans les ruralités, et nous commençons la préparation des 3èmes Rencontres Ecologies rurales et populaires à la Maison de Courcelles (Haute-Marne), avec le MRJC et Relier fin mai prochain. D’autres moments sont en préparation, et notamment un cycle de séminaires sera proposé pour l’année à venir. D’ici là, des interviews vidéos seront mises en ligne sur le site du post-urbain, une tribune sera publiée sur les mesures à engager selon nous pour les ruralités, des notes de réflexion seront diffusées (à la suite des dix déjà mises en ligne) et un ouvrage est en cours de confection. Voilà pour le programme d’actions pour les mois à venir.
Par mis les derniers ouvrages de Guillaume Faburel
[1] Entretien mené par Pascale Égré les 16 et 29 novembre 1992, repris dansLa société à la dérive, 2005, Seuil, p. 314.
[2] 2024, L’écologie peut-elle être populaire ?, Le Bord de l’eau.
[3] 2023, « Getting by in rural France: la débrouille as a form of quiet popular resistance? », European Journal of Cultural and Political Sociology, vol. 10, no 1, p. 127-151
[4] Paul Ariès, 2015, Écologie et cultures populaires. Les modes de vie populaires au secours de la planète, Paris, Utopia.
[5] « Gilets jaunes. Vers de nouvelles écologies populaires ? », Dossier Écologie & Politique, vol. 62, n° 1, 2021.
[6] 2017, Héritage de ce temps, traduit par Jean Lacoste, Klincksieck.
[7] 2024, Des électeurs ordinaires. Enquête sur la normalisation de l’extrême droite, Seuil.
[8] Erik Olin Wright, 2020, Stratégies anticapitalistes pour le xxie siècle, traduit de l’anglais par Christophe Jaquet et Rémy Toulouse, La Découverte.
[9] Antonio Gramsci, 1983 (1932), La philosophie de la praxis face à la réduction mécaniste du matérialisme historique. L’anti-Boukharine (cahier 11),trad. de Jean Bramon, Gilbert Moget, Armand Monjo, François Ricci et André Tosel, Éditions sociales.
[10] Maurice le Lannou, 1967, Le déménagement du territoire. Rêverie d’un géographe, Seuil. Expression reprise par Jacques Ellul en 1978 dans « Aménager ou déménager le territoire », Journal Ouest-France
[11] Clara Breteau, 2023, « Le murmure d’un autre récit national », Revue Analyse Opinion Critique – AOC, 20 janvier.
[12] Raphaël Lhomme, Guillaume Faburel, 2023, « Face à l’écocide, toute biorégion sera post-urbaine ou ne pourra être ! », Note de Glossaire du Mouvement post-urbain (www.post-urbain.org).