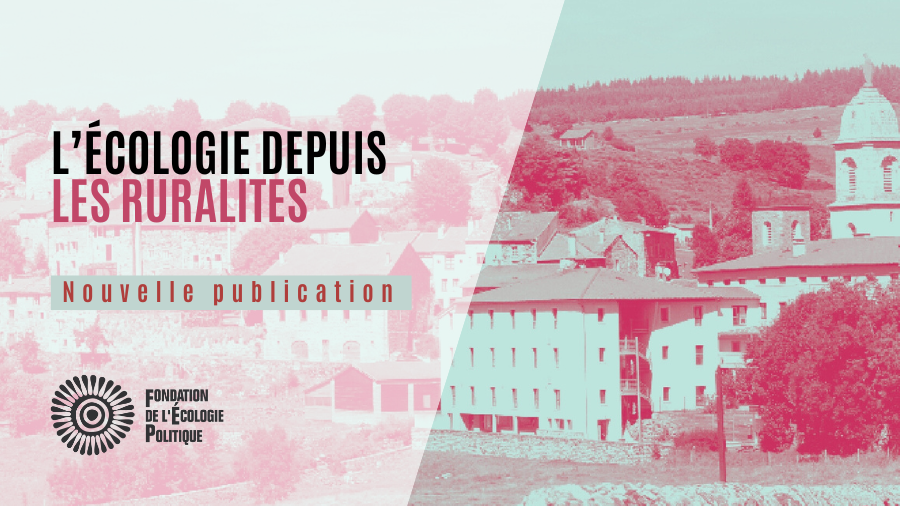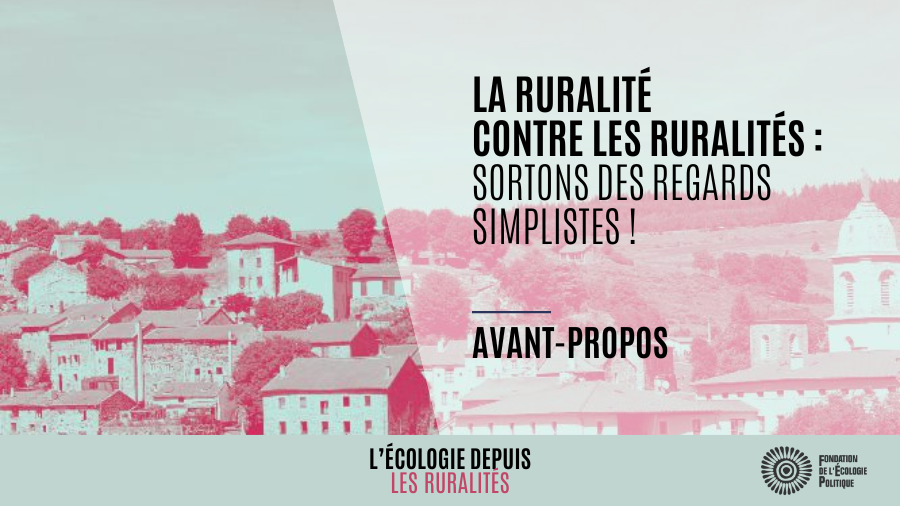Ces territoires ruraux, pour une grande partie d’entre eux, furent relégués, au temps des projets autoroutiers, des lignes TGV et de l’attractivité des grandes métropoles, au rang de territoires “à traverser et non à mailler” pour reprendre les mots d’Aurore Flipo. Mais alors que les ruralités et leurs habitant.e.s retrouvent peu à peu une centralité dans le débat public, ce dernier reste trop largement organisé autour de la “ruralité”, au singulier. Présentée comme un grand tout largement homogène, elle est souvent pensée et résumée à son opposition aux grandes villes françaises. Au risque de s’enfermer collectivement dans une impasse intellectuelle et politique.
Un étendard nostalgique
La “défense de la ruralité” de certains groupes de pressions ou de certains appareils politiques ne s’embarrasse que de peu de nuances. Et pour cause, la rhétorique de l’opposition aux grandes villes et aux dirigeant·es “déconnecté·es” permet d’invisibiliser une grande partie des enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui se jouent dans les ruralités. Cette opposition devient alors un outil puissant d’anesthésie politique, en alimentant une vision figée d’une ruralité qui serait homogène et correspondrait aux fantasmes d’une « Terre qui ne ment pas ». À sa manière, elle maintient une forme de relégation politique des ruralités, résumées à quelques portes-parles plus ou moins représentatifs. D’autant plus lorsque la “défense de la ruralité” se mue en étendard nostalgique, plus prescriptif que descriptif, brandie pour fédérer les esprits les plus conservateurs dans une période de polarisation politique particulièrement marquée.
L’infructueuse recherche d’acceptabilité ou de désirabilité
Que répondre à cela ? Depuis le mouvement des Gilets jaunes, de nombreux acteurs de la transformation sociale et écologique tentent de répondre sincèrement aux enjeux posés par le risque de “fractures françaises”. La “transition juste” devenant ainsi, et à juste titre, le mot d’ordre de celles et ceux qui prennent au sérieux la question de l’habitabilité de la planète.
Dans ce sillage, de nombreuses initiatives et travaux ont ainsi posé la question de l’acceptabilité ou de la désirabilité de la transformation écologique. Mais grande est la tentation – parfois à défaut d’une meilleure option – de réduire les réticences et oppositions aux feuilles de routes de la transition écologique, à l’idée d’une incompréhension au sein de la société. Incompréhension qu’un travail sur le design des politiques publiques, ou leur mise en récit pourrait résoudre. Quel que soit l’effort mis à l’ouvrage, la démarche tend à maintenir des habitant.e.s des ruralités dans une situation spectatrice. Elle maintient comme point de départ les feuilles de routes et les revendications politiques pensées et produites par des espaces humains ou institutionnels sociologiquement très marqués. Elle rate donc la possibilité d’un détour par le quotidien des Français.e.s et la possibilité de s’appuyer sur des revendications (par ailleurs écolo-compatibles) forgées dans le quotidien et les aspirations des classes moyennes et populaires des territoires ruraux et périurbains. Et avec elle la possibilité de voir émerger de nouvelles figures associatives et politiques, plus représentatives de ces territoires.
Avec cette Écologie depuis les ruralités, la Fondation de l’écologie politique poursuit le travail entamé avec l’Écologie depuis les ronds-points de mise à disposition plus large de travaux et réflexions issues des sciences sociales. Des notes et entretiens que vous allez pouvoir lire, il faut certainement en retenir quelques points clés :
L’opposition ruralités Vs Grandes villes, une erreur d’analyse
Il faut le redire, définir les ruralités dans leur seule opposition aux grandes villes, c’est à la fois : reproduire un exercice de définition qui fut longtemps celui de l’Etat – les ruralités sont les territoires non-urbains – ; mais aussi rater la diversité des territoires et des comportement électoraux qui s’y expriment. La note co-signée par le géographe Pierre Pistre, appuyée sur les derniers travaux de typologie des ruralités permet de déconstruire l’idée que toutes les ruralités voteraient moins écologiste que le reste du pays et qu’inversement elles seraient de manière homogène des bastions du Rassemblement National.
Regarder en face la diversité des ruralités
Cette diversité de situations est une invitation à aller plus loin, jusque dans le quotidien, notamment des classes moyennes et populaires vivant dans les ruralités. Les entretiens avec les sociologues Benoît Coquard et Fanny Hugues offrent des points d’entrée et des clés de compréhension importantes.
La nature, objet de discussions et de tensions intergénérationnelles
L’entretien réalisé avec Benoît Coquard est né d’une phrase dans son enquête de référence Ceux qui restent. Il y écrit que l’écologie est le seul sujet de clivage intergénérationnel. Cet entretien est l’occasion de revenir sur le rapport à la nature des habitant.e.s de ruralités marquées par un passé industriel et/ou une agriculture conventionnelle. Il s’y construit et entretient un rapport productiviste à la nature. Que peut-on en tirer ? Qui ? Jusqu’où ? Autant de questions qui peuvent structurer les tensions sur la chasse ou sur l’alimentation par exemple. L’entretien est aussi l’occasion d’aborder la question du rapport à l’autonomie et à la consommation qui, sans marquer un attachement à l’écologie, remet au premier plan des réflexes de débrouille, de sobriété et de rejet d’une forme de facilité à consommer que le lien intergénérationnel tend à entretenir.
La débrouille, un mode de vie invisible pour les institutions
L’entretien avec Fanny Hugues vient en écho à ces observations et permet, de manière plus transverse, de s’intéresser aux pratiques d’une partie des classes populaires rurales. Le mode de vie des “modestes économes” ouvre une fenêtre sur ce travail, cette débrouille que les statistiques institutionnelles ne voient pas. La défense de ce temps de la débrouille et de l’autonomie émerge comme une revendication importante dans une période où, au nom de la chasse à l’assistanat, l’équilibre de ces modes de vie modestes pourrait être mis à mal. Ce temps est pourtant productif et est fait de liens de solidarités et de soin apportés aux gens et aux choses.
La voiture, mal traitée?
Avec Aurore Flipo, nous prenons le temps de revenir sur le sujet fondamental de la mobilité, qui, contrairement à d’autres, est un enjeu commun aux ruralités. La voiture est un objet considéré comme maltraité et avec elle les habitant.e.s dont le mode de vie en dépend. Après des décennies d’une certaine forme d’aménagement du territoire, c’est de la possibilité de sortir du “tout voiture” qu’analyse Aurore Flipo à partir de travaux sur plusieurs territoires ruraux. Car si l’objet peut être maltraité, c’est aussi que le développement de mobilités complémentaires ou alternatives est mal traitée par les différents échelons de la puissance publique. L’enjeu est pourtant majeur lorsqu’il s’agit de publics – jeunes, seniors, personnes en situations de handicap – qui subissent alors une forme d’exclusion. Et ce n’est pas faute d’avoir vu émerger, pour des raisons sociales ou environnementales, des associations et collectifs prêts à s’emparer de ces sujets, mais qui trop souvent butent sur une processus décisionnel complexe et sans responsable clair.
Le rôle des choix politiques et des investissements
Au point que la gestion des failles de la mobilité dans les ruralités est souvent renvoyée à la responsabilité individuelle et à l’entraide. Pourtant, le travail d’Aurore Flipo souligne la grande hétérogénéité des situations institutionnelles. Certains territoires ruraux s’étant emparé des évolutions récentes de la loi quand d’autres, parfois sous la pression politique des centres de pouvoir régionaux, temporisent. C’est au fond une bonne nouvelle. Il y a des marges de manœuvres et certains territoires ruraux explorent des chemins nouveaux, loin de tout esprit de résignation ou de facilité.
Bonne lecture !